Saint Thomas en Chine, ou l’expansion universelle du Christ et la particularité occidentale
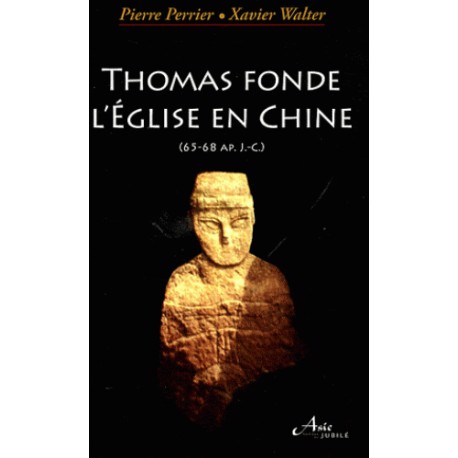
Nous lisions tantôt un très intéressant livre de Pierre Perrier, membre du CNRS, archéologue et historien spécialiste de la transmission orale des évangiles, et Xavier Walter, sinologue, intitulé Thomas fonde l’Église en Chine (65-68 ap. J.-C.) et publié aux éditions du Jubilé1.
Si l’ouvrage est une œuvre de vulgarisation, et mériterait ici ou là d’être plus développé afin de mieux faire comprendre aux non-spécialistes la méthodologie en archéologie, il garde le grand mérite de présenter un pan inconnu de l’histoire apostolique.
Nous connaissons bien sûr bien les évangélisations des saints Pierre et Paul, et pour cause, puisqu’ils sont les deux piliers de l’Église, et que tant de textes composent le canon du Nouveau Testament. Nous connaissons aussi souvent l’évangélisation de la Gaule, qui a commencé excessivement tôt après l’Ascension, avec l’arrivée de sainte Marie-Madeleine sur la côté méditerranéenne, jusqu’au IIIe siècle de notre ère. Nous connaissons en revanche beaucoup moins les missions en Perse, et dans le monde Parthe, voire dans le monde judaïque (à l’est et au nord de la Palestine). Très peu, encore, sont ceux qui savent que saint Thomas et saint Barthélémy ont visité l’Asie en profondeur, à travers la route de la soie, puis par la mer, jusqu’en Inde. Saint Thomas fut l’évangélisateur des Indes, ce que certains savent, mais il fut aussi évangélisateur en Chine ! Selon la tradition, il fit même un court passage à Kyushu, au Japon.
Thomas fonde l’Église en Chine jette un pavé dans la mare des idées communes en Asie, y compris parmi les chercheurs : des découvertes archéologiques, mises en relation avec les traditions chrétiennes sur Saint Thomas, et les annales chinoises, permettent de confirmer l’évangélisation de la Chine des Hans avec un grand succès par Saint Thomas : douze évêques en Chine ; un au Japon.
La preuve la plus importante de cette présence chrétienne en Chine est certainement sa figuration-même dans les annales officielles chinoises : il y est relaté que l’empereur Mingdu, en 64, reçut en songe l’apparition d’un homme lumineux et étranger (c’est-à-dire ni chinois, ni parthe, ni indien). L’empereur s’enquérait de la signification de ce rêve, quand Saint Thomas arriva l’année suivante, en 65 ! Les bouddhistes ont bien plus tard affirmé que cet homme providentiel était l’un des premiers missionnaires bouddhistes venus en Chine depuis l’Inde, mais cela est chronologiquement impossible, et le type de ce personnage ne correspond en rien à un Indien, ni à un bonze. Pierre Perrier émet l’hypothèse que l’homme apparu en songe n’était autre que le Christ, ce qui expliquerait les faveurs impériales accordées à Thomas dès son arrivée, car les traditions sur l’apôtre indiquent qu’il ressemblait comme deux gouttes d’eau à Notre Seigneur. Ainsi, l’empereur aurait vu en Saint Thomas le protagoniste de son rêve mystique. Voilà pourquoi nous avons une trace de cette visite thomasiennes dans les annales, mais aussi dans des bas-reliefs monumentaux du Ier siècle, dont la lecture, selon les analyses tout à fait convaincantes de Pierre Perrier, ne peut être que chrétienne. Cela signifie que, en Chine, le christianisme est arrivé bien avant le bouddhisme.
Nous apprenons au passage que le bouddhisme a été fortement influencé par la culture hellénique, apportée par les conquêtes d’Alexandre, et que les fameux « soutras », dans la forme que nous leur connaissons, sont inspirés des écrits chrétiens (pas sur le fond, évidemment). Le mot soutra viendrait d’ailleurs de l’araméen souartha qui signifie « bonne nouvelle2 » ! L’araméen était en effet une langue vernaculaire majeure sur toute la route de la soie, qui étaient évidemment un lieu privilégié de la diaspora juive depuis des siècles.
Saint Thomas a même réussi à convertir un prince de la famille impériale, qui se fera plus tard persécuté. Comme partout ailleurs, après une forte montée du christianisme, les persécutions commencent… La Chine fut encore ensuite travaillée par les missionnaires chrétiens de l’Église dite « nestorienne3 » aux Ve, VIe et VIIe siècles, puis, bien plus tard, avec Matteo Ricci, au XVIe siècle. La Chine fut ainsi travaillée depuis les débuts du christianisme jusqu’à aujourd’hui, ce qui permet à de nombreuses âmes d’être sauvées !
Cela permet de donner un argument apologétique fort sur la nécessité de relire l’histoire à la lumière providentielle : la Chine, comme l’Inde, et comme à peu près toutes les « paganies » ont été évangélisés dès le départ et peu après l’Ascension, par les apôtres eux-mêmes, et donc influencés par l’Évangile (jusque dans leurs dites « grandes » religions, comme le bouddhisme ou le taoïsme). Malheureusement pour eux, chacun de ces empires ont refusé le Christ, et ont persécuté ses disciples, se faisant ainsi ennemis du Christ : la Chine, comme les autres pays, n’est pas simplement « païenne » — comme le serait une tribu indienne n’ayant jamais entendu parler du Christ —, non, ces nations ne sont pas en dehors de l’économie providentielle de l’histoire ; elles ont refusé l’Évangile !
Toute cette histoire nous donne un enseignement important sur la spécificité occidentale, voulue par la Providence : si l’Évangile a été porté sur toute la terre, c’est seulement au sein de l’empire romain que les « États » se sont convertis, avec Constantin, mais surtout avec Théodose, puis Clovis. Ainsi, en Occident, les structures étatiques devinrent chrétiennes, et peu à peu, ce fut le cas de toutes les institutions. Cela n’est dû en rien à une qualité occidentale particulière : comme partout ailleurs, les États avaient commencé par persécuter violemment les chrétiens, et cela pendant des siècles. Constantin n’arriva qu’au IVe siècle — et ne se convertit vraiment que sur son lit de mort —, avant que Julien l’Apostat tentât de détruire la Chrétienté naissante. Il a fallu près de cinq siècles pour obtenir un premier État chrétien après la fin de toute persécution païenne : ce fut la France de Clovis !
Ailleurs, les chrétiens n’ont pas pu survivre, car l’État (entendez les princes et les chefs) ne s’était pas converti ! Cela permet de comprendre l’importance de la politique, et l’importance de la conversion des chefs avant tout le reste.
Cela permet encore d’affirmer nos conviction anti-républicaines, anti-démocratiques, et anti-libérales : une démocratie empêche structurellement toute conversion d’une « nation ». Pourquoi ? Car l’autorité est niée en tant que telle. Officiellement, il n’y a pas de chef. Supposons l’impossible en France : que Macron se convertisse demain au Christ, et pas à moitié. Que se passera-t-il ? Rien, il se fera remplacé par quelqu’un d’autre, puisqu’il n’est rien d’autre que le pantin de la « volonté générale » (et de divers loges et lobbys, en pratique).
Alors, oui, la Restauration du Christ en toute chose ne peut sérieusement commencer que par la restauration du Christ au cœur de la nation, par son lieutenant sur terre, le Roi de France, dont l’autorité ne dépend que de Dieu. Une conversion politique est nécessaire pour la conversion en masse des âmes au Christ, or la démocratie et la République rendent cela structurellement impossible.
Tout catholique devrait donc être anti-républicain et anti-démocrate. Et, pour la partie positive : en France, il ne peut qu’être légitimiste.
Paul-Raymond du Lac
Pour Dieu, pour le Roi, pour la France !
1 Nous remercions d’ailleurs un lecteur de VG, qui nous a fait connaître ce livre.

Il y a eu bien d’autres publications depuis, en France et en Inde, 3 colloques internationaux ; c’est assez étonnant que l’auteur ne les connaisse pas : voir https://www.eecho.fr/colloque-de-rome-2021-sur-st-thomas-un-tournant/
Merci pour ces bonnes informations! Ce genre de commentaire est toujours très apprécié et appréciable, cela aide au travail de nos auteurs.
La théorie de Pierre Perrier n’a été confirmée par aucun historien.
Ce propos n’est pas exact, il n’est simplement pas admis dans le sérail laïcard des experts d’extrême orient, d’autant plus qu’il se place dans la lignée de Jousse, et qu’il n’est pas au départ du monde universitaire, ayant des expériences bien plus larges, ce qui ne peut qu’énerver le sérail. Et il n’est pas non plus apprécié de casser le “mythe” de l’Orient riant, non chrétien et exotique.
Personne ne veut vraiment analyser sa thèse car elle gêne puisque trop chrétienne, et appelant de nombreux domaines d’expertises. Ses recherches confirment de plus trop les traditions orales sur saint Thomas, ce qu’un historien du sérail ne peut que détester, puisqu’il ne jute que par la source historique écrite.
Idem pour la traduction, si l’on part du principe qu’il n’y a que des bouddhistes, et qu’on fait semblant d’ignorer l’histoire chrétienne – ce que font tous les historiens de l’Orient, encore plus quand il s’agit d’histoire des religions, il n’est pas étonnant que les traductions diffèrent, sachant que le chinois de cette époque est tellement sommaire que l’on peut tout à fait traduire de façon très différente (il faut forcément avoir un parti pris dans la traduction).
Soulignons encore qu’il n’a pas travailler seul et a impliqué des spécialistes divers.
Il n’y a aucune raison de rejeter ses thèses, d’autant plus qu’elles correspondent bien aux traditions que nous avons, aux données de la Foi. Sans compter les faisceaux d’indice dans les pays d’Asie.
Parlons justement de source écrite. Tous les documents anciens chinois ont été recensés et traduits par Henri Maspéro. D’après Sylvie Hureau, spécialiste mondiale des traductions des textes chinois anciens, ces traductions “n’ont pas pris une ride”. Or, Pierre Perrier, sans citer le texte qu’il traduit, sans citer son traducteur et sans citer toutes les traductions de Henri Maspéro “invente” une traduction évoquant un homme blond, d’une taille de 2 mètres et à la peau claire.
Par ailleurs, Pierre Perrier :
– Considère le songe de Mingdi comme historique (alors que tous les sinologues le considèrent come une invention du IIe siècle).
– Affirme que le bouddhisme n’est arrivé en Chine qu’au IIe siècle, contrairement à tous les sinologues (y compris Xavier Walter) qui situent son arrivée en Chine au plus tard au Ier siècle av. J.-C.
– Date la frise de Kong Wang Shan des années 70, sans aucune justification
– Déforme les noms des deux missionnaires envoyés par l’empereur en leur attribuant des étymologies araméennes.
– Identifie sur la fresque de Kong Wang Shan des signes chrétiens, alors que ceux-ci n’ont pas été utilisés avant le IVe siècle.
Le livre de Pierre Perrier ne respecte pas la déontologie des historiens, ne donne pas ses source
et affirme sans preuve. Ce n’est pas le travail d’un historien.
Cher Monsieur, je ne sais pas ce que vous avez contre Pierre Perrier, mais vous exagérez. Il ne sedit pas historien d’ailleurs. Et vous savez très bien que pour l’antiquité l’histoire ne suffit pas, encore moins en Asie où lmes sources sont plus qu’éparses.
Vous savez aussi que le chinois ancien est traduisible de façon très varié, et les traductions françaises forcément des interprétations : alors elles ne peuvent que prendre des rides… Pierre Perrier d’ailleurs ne se dit pas sinologue, il conte sur un collèguesinologue poure confirmer que son intérprétation n’est pas linguistement fausse
Par ailleurs
– en quoi faudrait-il considérer que le song n’est pas historique? C’est une vieille marotte des positivistes du xixe de vouloir remettre en cause toutes les sources, déjà éparses, et leur contenu dès que cela parle de quelque chose qui sort de l’ordinaire. Il est plus logique de penser que ce n’est pas une invention: les païens omettent souvent certes, enjolivent parfois, mais mentent rarement. De plus, une “invention” du IIe siècle, c’est vraiment proche, surtout à cette époque (vous m’auriez dit une invention du XVIe, on aurait pu discuter)
-Citez moi le passage je vous prie de l’arrivée? Je n’ai pas souvenance qu’il dise cela (je n’ai pas le livre sous la main présentement). C’est lointain, mais dans mon souvenir, il parle non pas de l’arrivée de quelques missionaires, datés habituellement de l’an -2 (ce à quoi vous devez faire référence j’imagine?) mais de la réception officielle d’ambassade. Sa thèse est justement de dire que les premières ambassades reues officiellement ne sont pas celle de Ming-Di de 65-68 mais au IIe siècle seulement.
Vous avez vraiment lu en détail le livre?
-Je suis assez persuadé qu’il donne des justifications dans mon souvenir, vous pourriez citer? Des justifications de contexte, en particulier d’histoire de l’art entre stymle taoïsste, proto-bouddhique et apostolique si ma mémoire est bonne, me semblent convaincants. pourriez-vous citer ce passage de son livre si possible, si je me trompe?
– déforme de quoi? en philologue et expert de l’oralité il est bien placé pour savoir que des noms se changent en fonction des cultures. En tant que japonologue, je le constate souvent, surtout dans des langues aussi éloignées, par exemple en chinois du 15e pour dire franc, on dit franqi avec des idéogrammes. Et il y a de nombreuses déformations en chinois (prenez tous les mots indiens bouddhiques sinisés déjà, et les noms). On n’est pas obligé d’être d’accord avec lui, mais cela se tient, et probable vue le contexte culturel et de l’époque
-vous pourriez préciser et citez? Dans mon souvenir, justement, il identifie des signes de cette époque précise, qui disparaisse ensuite de la représentation chrétienne!
Je revérifierai de mon côté aussi
Mais admettez que le problème que vous avez avec son histoire, c’est qu’il est jhustement pluriodisciplinaire, et regarde les traditions orales orientales – qui, si vous avez un peu la foi, n’ont aucune raison d’être fausses, et en ont plein d’être exact (sachant évidemment que ce n’est pas une chronique de greffier).
Il affirme avezc des preuves, mais pas qu’historique. IUl fait appel à laphilologie, histoire de l’art, archéologie, science des religions.
C’est un vrai scientifique du CNRS, qui met un coup dans la fourmilière du sérail – que je connaîs bien – des historiens et plus encore des orientalistes, qui veulent en occident (et en particulier en France) conserver le monopole d’une sorte de science infuse d’autorité sur leur domaine, qui garde de vieux relents du XIXe.
LA thèse de Perrier, jsutement parce qu’elle dérange, devrait au contraire être l’occasion de véritables débats pour faire avancer la science, et pas l’objet d’un mépris insupportable de gens orgueilleux qui croyent savoir.
Je pense que nous assistons heureusement à un retour d’une véritable science éclairée par la philosophie (des principes) et la théologie catholique, après une éclipse terrible après la révolution française et son positivisme aseptisant et destructeur.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’université, dans le monde entier, est en déliquescence et traverse une crise profonde : cela est logique, elle a perdu la vrai Foi, et donc sans la foi pas de raison solide qui tienne. Là je vais beaucoup plus loin, mais au fond, l’affaire Perrier évoque ce problème.
Dans ce livre, Pierre Perrier donne une traduction très originale des textes chinois anciens relatifs au songe de Mingdi, en opposition complète avec les traductions proposées par Henri Maspéro. La théorie de Pierre Perrier n’a été suivie par aucun historien et très critiquée par Anne Cheng au Collège de France.
Il semblerait que mon commentaire ne puisse pas être publié (?)
Cher Monsieur,
Vous me demandez si j’ai lu le livre de Pierre perrier en détail. J’ai fait plus que le lire puisque j’ai passé plus de 100 heures à l’analyser, à essayer de trouver les sources sur lesquelles l’auteur s’était appuyé (sans succès), à trouver beaucoup de sources contradictoires à ce qu’il avait écrit (toutes postérieures au XIXe siècle), à dialoguer par mail avec l’auteur sans obtenir qu’il réponde à l’une de mes questions…
J’ai effectué tout ce travail entre 2013 et 2016 et j’ai fait part de l’essentiel de mes recherches, au fil de celles-ci, sur le sous-forum “Histoire”, dans “Salons thématiques” du forum “La Cité Catholique”, dans le sujet “L’Apôtre Thomas en Chine ?”. Vous pouvez consulter : https://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?f=28&t=6156&start=45
Je suis intervenu dans ce forum sous le pseudo “diviacus”. Si vous avez le courage de lire tout ce que j’ai écrit, vous aurez toutes les réponses, détaillées, avec les sources et les références des pages du livre de Pierre Perrier, aux questions que vous m’avez posées.
La discussion se termine sur un très bref compte-rendu d’Anne Cheng au Collège de France qui qualifie l’hypothèse de Pierre Perrier de “spéculation fantaisiste et peu fondée, mais affirmée avec aplomb”.
Si jamais vous avez des questions précises à me poser, j’y répondrai avec plaisir.
Bien cordialement.
François Remise
Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre lien que je regarde avec attention.
Je pense que le fond du problème pour vous c’est qu’il n’est pas du sérail et que sa thèse est pourtante plus que probable, au vue de la véracité quasi-systématique des traditions apostoliques.
Que sa thèse demande des développements et des affinements, certes, mais cela ne change rien au fond.
Je note que vous n’avez produit aucun papier sur le sujet et que l’on reste dans le cadre d’un forum informel.
Que les “professeurs” pignon sur rue ne s’y attaquent pas frontalement – ont-ils peur de creuser le sujet?
Je note encore que vous n’apportez pas plus d’arguments que vous avez apporté ici, essentiellement fondé sur “l’autorité” d’Anne Cheng et de la traduction de Mapéro, c’est léger.
En particulier sur la question de la traduction du chinois ancien – vous ne parlez pas chinois j’imagine?-, ni des questions de l’oralité, ni des questions de la validité des sources historiques de ces époques. Les points que vous soulevez sont mineurs en fait, et vous ne répondez à la question cruciale des traditions orales.
Encore sur la question de l’interprétation linguistique des noms, c’est toujours compliqué, mais au fond pas si décisif: on sait très bien que les cultures locales assimilent avec leur mot ce qui vient de l’extérieur: au Japon quand les premiers missionnaires arrivent, si on avait que les sources japonaises, on croirait que Saint François Xavier est un bouddhiste, car tout le vocabulaire employé sur lui est bouddhiste, et pourtant il est chrétien!
Il n’est pas étonnant que saint Thomas, apportant une religion inconue, soit décrit avec les mots des religions indiennes, chinoises, etc. Effectivement l’interprétation de Perrier est certainement contestable sur ce point, mais ce n’est pas décifis du tout.
Sur la critique de la datation du songe de Ming et de l’arrivée du bouddhisme, c’est la même chose: on sait très bien que dire que le songe est d’un point de vue source élaboré au IIe ne veut pas dire qu’il n’est ni historique ni ne date de 69, au contraire. Prenons l’exemple du testament de saint rémi, longtemps considéré comme un faux, mais réhabilité par feu Michel Rouche de façon définitive.
J’ai encore lu les échanges avec M Perrier, vous avez eu son autorisation de les publier?
Je trouve qu’il est gentil de vous avoir répondu, alors que vous n’avez rien à voir avec la choucroute et que votre but est simplement de le démonter et non pas de faire avancer la recherche.
Enfin, vous semblez oublier et sous-estimer l’idéologie rad-soc, esotérique et anti-chrétienne de la tradition orientaliste en France, hyper prégnante. C’est en soi un signe qu’il ne faut pas perdre de vue pour comprendre le rejet de Perrier par le sérail – qui ne veut pas considérer d’ailleurs le travail des missionaires, etc, qui connaissent depuis bien plus longtemps ces pays.
N’oublions pas, en particulier sur le bouddhisme, que ces hommes ont voulu y cherche une spiritualité anti-chrétienne, qu’ils ont d’ailleurs systématiser – mais qui n’exiszte pas sous cette forme systématique et dogmatique sur place – en l’unifiant malgré une diversité infinie.
J’ai beau tourné la question dans tous les sens mais je trouve que vous vous acharnez un peu trop sur lui en tentant de mettre le doute sans raison décisive, ni argument déginitif, et surtout que sur le fond il doit avoir raison – puisque les traditions apostoliques vont dans ce sens. Ecrire à tous ceux qui le reçoivent, dont lui, c’est pas un peu du harcelement? Auriez-vous une dent personnel contre lui pour une raison obscure?
Car si sa thèse est si fantaisiste que cela, laissez-faire les spécialistes et autre, et elle sera oubliée.
C’est dommage, car qu’on n’aime ou pas, l’important c’est de faire avancer la vérité. Et ses ouvrages le font visiblement.
Au fait, le fait de vouloir diffuser en dehors de l’université est aussi louable, et normalement du devoir du savant: comme le disait saint Thomas un chercheur ne se réalise qu’en transmettant ce qu’il a découvert, pas simplement en le sachant.
En définitive, le plus important argument sont les traditions orales sur saint Thomas: pourquoi seraient-elles fausses?
Au plaisir
ps: quand j’aurai le temps je reprendrai cette queestion avec livrfes en main, car le sujet est d’importance aussi pour le Japon, et il existe pas mal d’indices montrant une présence nestorienne ultérieure.
Cher Monsieur,
J’ai bien lu votre réponse précédente, dans laquelle vous n’apportez aucun contre-argument à ceux que j’ai développés sur le site déjà référencé. Je peux le comprendre, car j’en ai écrit beaucoup et que vous n’avez pas encore sérieusement étudié le sujet. Je vais aller à l’essentiel en démontant la prétendue démonstration faite par Pierre Perrier dans ce livre.
P. Perrier prétend démontrer que l’Apôtre Thomas a évangélisé la Chine, en affirmant que les sculptures de Kong Wang Shan sont chrétiennes et qu’elles datent des années 60 apr. J.-C., date qui serait compatible avec la venue de Thomas en Chine. Pour « appuyer » sa prétendue démonstration, P. Perrier affirme que le songe de Mingdi est historique (et non légendaire), et qu’un texte chinois affirme que « Mingdi eut un songe qui lui fit voir un homme blond, grand, dont la tête était auréolée de lumière, […] il avait près de deux mètres, il avait a peau claire ».
1- Datation des sculptures de Kong Wang Shan
P. Perrier affirme plusieurs fois que les sculptures datent des années 60 :
– Page 14 : « La date attribuée à ce tableau rupestre, les années 60… »
– Page 33 : « La découverte assurément datée… »
– Page 56 : « … sculptée sur cette paroi dans les années 60… »
– Page 83 : « … la plus ancienne attestation archéologique d’un ensemble complet antérieur à 70… »
– Page 106 : « Ainsi doit-on dater l’ensemble avant l’année 70… »
P. Perrier ne donne pas le moindre début de preuve, mais uniquement des affirmations.
2- Le songe de Mingdi
2.1- L’historicité de ce songe
P. Perrier ne remet pas une seule fois en doute l’historicité de ce songe. Or la majorité des spécialistes considère que les songe de Mingdi est une légende (Vincent Goossaert, Daisaku Ikeda, Lou Yulie, Paul Demiéville, Antonello Palumbo, Tan Ta Sen, Marcel Granet, Henri Maspéro, Jacques Gernet, Elisabeth Martens, Bernard Baudoin, Frédéric Wang, Jacques Brosse, Claude Chancel, Daisetz Teitaro Suzuki, Sylvie Hureau, Anne Cheng, etc.), et notamment :
– Antonello Palumbo (2007) : « We no longer believe that [the beginnings of Buddhism in China] all began with the dream and embassy of Emperor Ming of the Han dynasty – not since Henri Maspéro, back in 1910, showed us that this story bears all the traits of a pious legend. »
– Marcel Granet (1922) : « L’histoire du bouddhisme en Chine est sans doute destinée à rester mystérieuse. Les chroniqueurs officiels se sont avisés de parler de lui seulement à l’époque où il prit une importance politique. D’autre part dans les écrits bouddhistes, comme dans toute littérature religieuse fourmillent les supercheries pieuses ; pour certains, et des plus importants, les érudits hésitent, après les plus minutieuses recherches, à les dater à trois siècles près. Ce sont des productions de sectes rivales qui, souvent, ont cherché un supplément de prestige par de véritables faux. Il est établi, par exemple, qu’une communauté bouddhique inventa de toutes pièces une histoire destinée à accréditer l’idée que l’introduction de sa foi était due tout ensemble à un miracle et à une décision gouvernementale. En 65 ap. J-C, l’image d’une divinité nimbée du disque solaire serait apparue en songe à l’empereur Ming […]. Cette invention a eu pour résultat de faire maudire jusqu’à nos jours la mémoire de l’empereur Ming par les Chinois orthodoxes. En fait, on a la preuve que, dès avant le songe supposé, des communautés bouddhiques existaient en Chine … »
Sur ce sujet, vous pouvez lire : https://www.chineancienne.fr/maspero-le-songe-et-l-ambassade-de-l-empereur-ming/
« La première des deux légendes, rêve et ambassade, se présente assez mal : parmi les personnages mis en scène à côté de l’empereur, tous ceux qui sont connus par ailleurs sont invraisemblables : Tchang K’ien était mort depuis près de deux siècles ; Fou Yi n’a été appelé à la Cour que sous l’empereur Tchang ; le nom de Ts’in King est peut-être dû à un autre anachronisme ; seuls les noms de Ts’ai Yin et de Wang Tsouen ne font pas difficulté, mais le premier est dû à une correction postérieure ; quant au second, il est tout à fait inconnu. Toute cette série d’anachronismes trahit la tradition populaire. »
« En somme, l’histoire traditionnelle de l’introduction du bouddhisme en Chine repose toute entière sur quelques légendes pieuses de la fin du IIe siècle. L’autorité des histoires dynastiques qui l’ont acceptée, le Heou Han chou, le Wei chou, le Souei chou, ne doit pas faire oublier la faiblesse des sources. Il est important de constater que, juste à l’époque où Meou-tseu écrivait, le Wei lio racontait l’introduction du bouddhisme en Chine de façon toute différente et sans la moindre allusion à l’empereur Ming. »
Or, par ailleurs, P. Perrier et X. Walter ne manquent pas de rappeler que les traditions chinoises sont peu crédibles :
– X.Walter (page 20) : les écrits [chinois] qui y sont relatifs « fourmillant de supercheries, productions de sectes rivales ».
– P.Perrier (page 69) : « les bouddhistes sont de formidables hâbleurs »
– P.Perrier (page 163) : « toutes ces affirmations montrent combien traditions, compilations, souvenirs plus ou moins sincères contribuent à dénaturer l’histoire et à créer des certitudes, au crédit totalement infondées. »
Pourquoi les deux auteurs « oublient-ils » ce qu’ils ont écrit par ailleurs, et considèrent, contre l’avis très majoritaire des spécialistes, que le songe de Mingdi est historique ? Parce que sinon, toute leur « démonstration » tombe, puisque si l’invention de cette légende date du IIe siècle, les sculptures de Kong Wang Shan ne peuvent pas dater des années 60.
Encore une fois, pas le moindre début de preuve que ce songe est historique.
2.2- Le texte du songe de Mingdi
Sur la traduction du songe de Mingdi, on atteint le summum.
Pierre Perrier donne plusieurs traductions, ou rappelle ce songe de Mingdi, en 4ème de couverture, et aux pages 13, 19, 31, 40/41/42, 54, 89, 95/96/97/98, 100/101/102/103, 105, 166/167, 185/186, et 188. Il écrit à la page 96 que c’est une pièce capitale, et c’est vrai.
Version de la page 41 : « Mingdi eut un songe qui lui fit voir un homme blond, grand, dont la tête était auréolée de lumière,[…]il avait près de deux mètres, il était de teint doré… »
Il en déduit page 42, que cet homme grand, aux cheveux blonds ou châtains et à la peau claire (??) ne peut être a priori un Chinois, ni un Indien, et il en déduit page 101 que « la description que l’empereur Mingdi a donnée de lui recouvre les sémites du Nord, d’un blond châtain, à la peau hâlé (sic), de taille plutôt grande… ». Il conclut plus tard que ce ne peut être que Jésus Christ.
Dans toutes les traductions faites jusqu’à présent, aucune ne comprend les mots « cheveux blonds », « à la peau claire » ni « « d’une taille d’environ 2 mètres », sauf celles de Pierre Perrier.
Le document qui fait référence sur la question est l’article de 37 pages de Henri Maspéro « Le songe et l’ambassade de l’Empereur Ming. Etude critique des sources » 1 qui date de 1910. Aucun article ni livre n’a depuis mis en doute la qualité des traductions données par H.Maspéro. Sylvie Hureau, spécialiste de l’introduction du Bouddhisme en Chine et professeur à l’EPHE dit que l’article « n’a pas pris une ride ». Elle a fait un cours sur ce sujet en juin de cette année à l’EPHE, où elle confirme toutes les traductions données par Henri Maspéro.
Les traductions des 13 textes antérieurs au VIe siècle données par H.Maspéro divergent un peu mais sont globalement cohérentes avec celle-ci :
C’est une tradition courante que l’empereur Ming vit en rêve un homme d’or de haute taille qui avait une lueur brillante au sommet du crâne. Il interrogea ses fonctionnaires ; et quelqu’un d’entre eux lui répondit : « Dans la région d’Occident, il y a un dieu appelé Buddha, d’une taille haute de seize pieds et qui est couleur d’or jaune ».
Ici l’homme vu en songe est d’or (ou doré), la couleur de sa peau n’est pas mentionnée, et sa taille est de 16 pieds (soit environ 4,80 m).
La seule indication qui diverge d’un texte à l’autre est la taille du personnage. Sur les 13 textes, 6 ne disent rien sur sa taille, 2 disent seulement qu’il est grand, 4 disent qu’il mesure 16 pieds (4,80 m) et un dit qu’il mesure 20 pieds (6,00 m).
Incapable de répondre aux questions que je lui ai posées sur ce texte, P. Perrier avoue alors que « le seul problème est qu’il manquait à cette époque (en 1910, à la date de l’écriture de l’article de Maspéro) un texte ancien de chronique impérial qui est en amont des variantes que nous avons utilisé (sic) ». Donc, P. Perrier justifie sa traduction innovante par le faut qu’un nouveau texte serait maintenant connu, qu’il ne cite évidemment pas. Et c’est Marion Duvauchel qui avoue : « M Perrier ne peut pas citer TOUTES ses sources. Le texte antérieur qu’il évoque (et il pris soin de le mettre en gras plus loin) est un texte que le père Yen a lu dans les archives royales, qu’il a consultées parce qu’il faisait partie de la famille royale par sa grand tante. Mais il a du s’enfuir précipitamment de Chine faute de finir au goulag, parce qu’il travaillait sur ces questions. C’est lui qui a vu ce texte, mais les archives dont désormais blindées et il est mort.
La réponse donnée par Marion Duvauchel est doublement invérifiable et complètement improbable :
– Doublement invérifiable :
Personne ne peut attester que le père Yen a lu dans les archives royales, et comme elle le dit elle-même « C’est lui qui a vu ce texte, mais les archives dont désormais blindées et il est mort. »
– Complètement improbable :
a- Henri Maspéro écrit en 1ère page de son document : « Cette histoire (le songe de Mingdi) est racontée par un grand nombre d’écrivains. Mais depuis la fin du VIème siècle tous ne font que reproduire un texte fixé pour la forme et pour le fond ». H.Maspéro étudie alors les 13 premiers textes. Aucun de ces textes ne comprend les mots « à la peau claire » et n’indique une hauteur du personnage de huit empans. Et ceci ne peut pas évidemment pas venir d’une interprétation de traduction !
Ni H.Maspéro, ni les 30 chercheurs de l’équipe de Pierre Perrier, n’ont été capables de trouver dans les textes anciens chinois un texte qui reprenne ces éléments (invérifiables).
C’est plus qu’improbable.
b- Le scenario est complètement invraisemblable.
c- Le père Yen n’est même pas cité parmi les 17 personnes qui ont contribué au livre (page 18). Pour la personne qui est la seule à avoir vu un texte qui est à la base de ce livre, il n’a même pas l’honneur de figurer parmi les contributeurs (alors que l’ami de P.Perrier « Li Fan Tsen, avec qui nous avons travaillé en mécanique des fluides » et « Diane Staune, dont l’enfance s’est passée à côté du temple du Cheval Blanc » y figurent !!).
Maintenant, supposons que cette histoire soit vraie.
Pierre Perrier a donc construit une hypothèse sur la base d’un élément invérifiable et invraisemblable, et il ne l’a pas dit !
Cela s’appelle un mensonge par omission et de la malhonnêteté intellectuelle.
Ce n’est pas seulement un mensonge par omission. Car non seulement Pierre Perrier aurait caché au lecteur l’incroyable fragilité de sa source, mais il a tout fait pour que ses lecteurs croient que cette source était vérifiable et indubitable, avec toute la rigueur déployée par une « équipe pluridisciplinaire de 30 chercheurs ».
3- L’arrivée du bouddhisme en Chine
X.Walter écrit page 19 : « Il est notoire que les premières traces du bouddhisme […] sont toutes, en Chine, postérieures au milieu de IIe siècle. »
Pierre Perrier écrit page 14 : « Elle [la date de la frise rupestre] ne cadre pas avec ce qu’établit l’histoire de l’arrivée en Chine du Bouddhisme dit du « Grand véhicule » depuis l’Inde occidentale que les Chinois appellent Juandu*, et par le Xinjiang, au milieu du IIe siècle, et que confirme l’archéologie. »
Or, en 2007, X.Walter écrit dans sa « Petite histoire de la Chine » que :
– « le bouddhisme aborde l’Empire dès le 1er siècle av. JC » (page 59).
– « Or, dès avant l’ère Mingdi, des communautés bouddhiques existaient notamment le long du Bas-Yangzi. » (page 60).
–
Après avoir co-écrit en 2008 avec Pierre Perrier, X. Walter change curieusement d’avis et écrit en 2009 dans un article sur le Bouddisme en Chine « on date désormais [l’arrivée du bouddhisme en Chine] du règne de Huandi (146-167)… »
C’est quasiment un des seuls auteurs à l’écrire, puisque la majorité des auteurs écrit que le bouddhisme a été introduit en Chine au plus tard au Ier siècle. (Voir liste d’auteurs cités précédemment).
Pourquoi P. Perrier et X. Walter feignent d’ignorer le quasi-consensus des spécialistes sur l’arrivée en Chine du bouddhisme ? Parce qu’ainsi, ils « éliminent » la possibilité que les sculptures de Kong Wang Shan puissent être attribuées au bouddhisme.
4- Les sculptures de Kong Wang Shan
P. Perrier se livre à un certain nombre d’observations, en croyant voir des signes chrétiens dans ces sculptures. Pour pouvoir discuter pertinemment son analyse, n’importe quel historien doit aller la voir sur place.
Un reportage photographique examiné « en usant des capacités de traitement d’images de mon ordinateur » (page 77) est largement insuffisant dans un contexte « normal ». Venant après les tromperies précédentes, cela ne peut que susciter une énorme méfiance.
Je ne peux donc pas faire une contre-analyse pertinente, mais seulement donner mes impressions :
L’interprétation ne peut être que subjective, mais je suis quand même très gêné par la restitution des photos en dessins :
– Le 1er personnage me semble bien asiatique sur la photo et beaucoup moins sur le dessin, grâce à des yeux nettement arrondis
– Le T figurant sur le corps de ce personnage est transformé en croix
– Je ne vois pas sur les photos les autres croix représentées sur le dessin 5.2, et encore amplifiées sur le dessin de la page 225
– L’enfant de la Vierge est impossible à deviner, et il est particulièrement maladroit d’avoir fait figurer une Vierge aux yeux bleus
Je suis encore plus gêné par les représentations de croix latine du dessin 5.2 car les chrétiens n’ont pas utilisé le symbole de la croix latine avant le IIe siècle. Elle apparaissait avant sous des formes dissimulées (mât, ancre, ascia, etc) [voir par exemple dans « Les premières images chrétiennes » de Frédérick Tristan (1996)]
Je suis également très gêné par les représentations d’auréoles des dessins 10.2 à 10.4, car les auréoles ne sont représentées par les chrétiens qu’à partir du IIIe ou IVe siècle (Référence déjà donnée).
Ce dossier photos et dessins ne me convainc pas. Les interprétations graphiques sont « poussées » pour aller dans le sens de la démonstration, et apparaissent dans ces dessins des éléments anachroniques.
Anne Cheng a fait une analyse beaucoup plus convaincante de ces sculptures (écouter ses 4 conférences au Collège de France en 2018).
________________
En bref, P. Perrier ne donne aucun début de preuve de ce qu’il avance. Mais, ce qui est plus grave, il manipule ses lecteurs en les laissant croire qu’il a fait preuve de beaucoup de rigueur (!) en multipliant les formules du genre « il est notoire », « il est clair » devant des affirmations qui, le plus souvent sont très discutables, voire fausses. Cela évite à P. Perrier d’en faire la démonstration.
Je trouve cela indigne d’un homme de foi.
________________
Cher Monsieur,
Vous vous répétez et désolé de vous le dire, vos arguments ne sont pas convaincants mais peu importe.
Vous ne répondez toujours pas sur le fait primordial de la valeur des traditions orales.
J’aurais simplement deux questions factuelles.
-Depuis quand lisez-vous Vexilla Galliae ?
-Le lisez-vous régulièrement?
Cher Monsieur,
J’avance des arguments détaillés et sourcés montrant que Pierre perrier n’a absolument aucune preuve de ce qu’il avance. Vous ne dites pas en quoi ils ne sont pas convaincants. Par manque de contre-arguments ?
En quoi, les traditions orales sont-elles un argument sur un des 5 points que j’ai détaillés ? Je suis prêt à accepter la contradiction, si vous avez des éléments factuels à énoncer.
Cher Monsieur,
J’explicite ma dernière question :
– Existe-t-il une tradition orale qui permet de dater les sculptures de Kong Wang Shan des années 60 ?
– Existe-t-il une tradition orale qui permet à Pierre Perrier de soutenir que sa traduction d’un texte inconnu par un traducteur inconnu contredit celles de Henri Maspéro qui n’a jamais été contredit par aucun sinologue ?
Pour répondre à votre question sur la valeurs des traditions chinoises, Pierre Perrier et son co-auteur ont clairement exprimé à trois reprises leur opinion selon laquelle elles étaient totalement infondées.
Vous avez survolé le livre de P. Perrier et survolé ce que j’ai écrit. Relisez son livre à la lumière de ce que j’ai écrit et essayez d’y apporter des contre-arguments concrets et sourcés.
Cher Monsieur,
En attendant vous n’avez répondu à mes questions.
Le fait d’éluder est manifeste:
-vous n’êtes pas un lecteur de ces colonnes n’est-ce pas?, et vous commentez pour la première fois sur ce texte: vous êtes venu diffamer M Perrier, sans aucun souci réel de science, sous couvert de critiques fondés.
-vous avez divulgué des conversations privées sans l’autorisation de l’auteur, n’est-ce pas?
-vous ne connaissez rien ni au chinois ancien, ni au japonais ancien, n’est-ce pas?
Vous n’avez rien publié nulle part, et vous cherchez à insinuer le doute chez des non-spécialistes.
Ici n’est pas le lieu de discutailler de façon oiseuse avec quelqu’un qui manifestement a un but autre que la vérité – vous avez une dent personnelle contre lui, n’est-ce pas? Sinon je ne comprends vraiment pas cette obsession.
Et vos réponses sont à côté de ce que je demande, vous continuez à vouloir démolir M Perrier, au détriment du fond de l’affaire, à savoir la véracité des traditions orales catholiques orientales d’origine apostolique.
Il est manifeste que votre intention est malveillante et tout porte à croire que vous dénigrez systématiquement M Perrier dès qu’il apparaît sur internet et ce depuis déjà des années.
Ici quatre exemples que j’ai trouvé (sous vos divers pseudo);
https://www.youtube.com/watch?v=epCJbfpjSUQ
https://www.amazon.fr/Thomas-fonde-lEglise-Chine-Jésus-Christ/dp/2866794826
https://www.decitre.fr/livres/thomas-fonde-l-eglise-en-chine-65-68-apres-jesus-christ-9782866794828.html
Vous ne servez ni la science, ni la Foi, ni le Roi en faisant cela
C’est de la malveillance inutile.
A bon entendeur