Les boulots bidons, par Antoine Michel
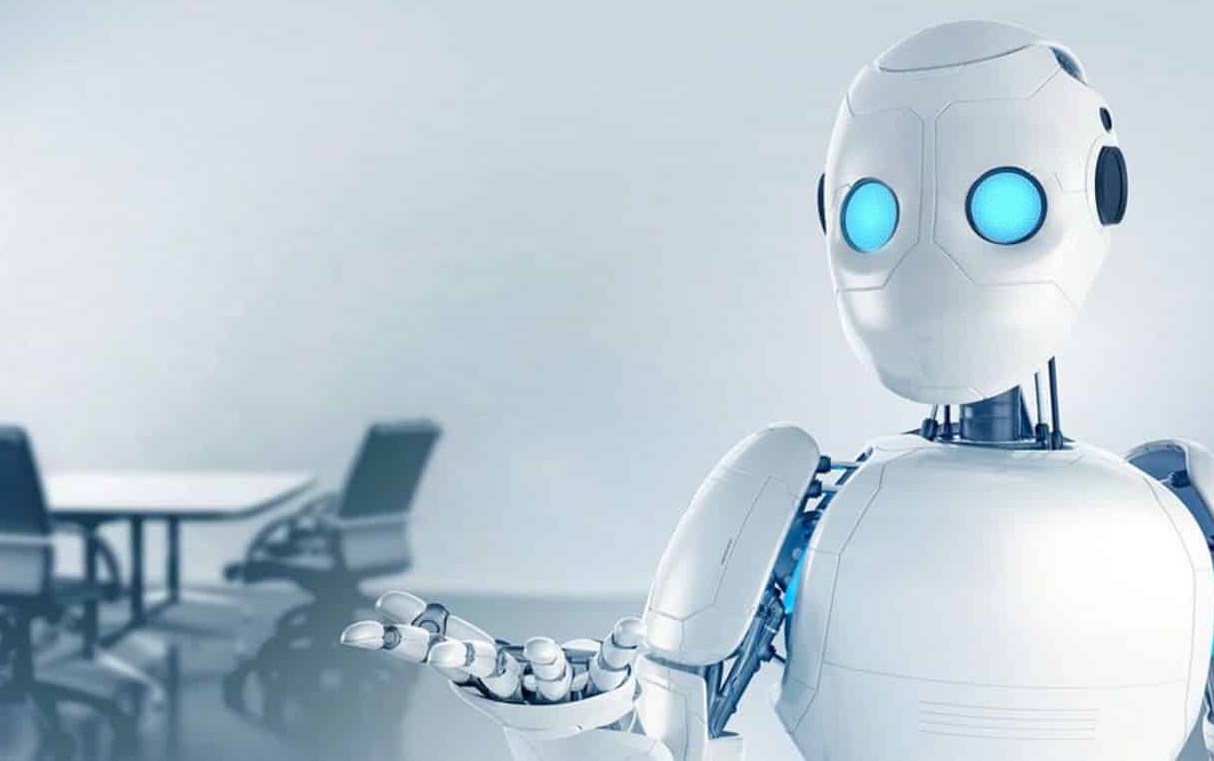
Stanislas Berton a présenté il y a quelques temps déjà une traduction d’un très bon article de l’anthropologue américain David Graeber sur les « emplois bidons » (bullshit jobs), article repris dans le volume III de ses Essais, aux éditions du Temps Retrouvé.
Tout se passe ici chez les Américains, qui ne sont pas connus pour faire dans la dentelle, le propos mériterait donc quelques nuances ou distinctions. Il faudrait en particulier rappeler que le travail n’est pas là pour nous faire plaisir, ni pour donner un sens à notre quotidien, mais pour notre perfectionnement moral. C’est aussi le cas pour les travaux les plus inutiles, les plus serviles, les plus avilissants ou les plus ennuyeux, qui représentent pour les âmes d’élite de bonnes mortifications, puisqu’elles les acceptent comme telles ! Il faudrait aussi mettre un bémol sur l’exagération alléguée quant aux conséquences du progrès technique, qui aurait pu selon l’anthropologue réduire le temps de travail à 15 à 20 heures par semaine : cela est utopique, l’homme ne devant pas, de toute façon, demeurer oisif. Comme dit le proverbe, l’oisiveté est la mère de tous les vices !
Dans un certain sens, ainsi, le phénomène que Graeber constate était inéluctable : si un certain progrès technique permet de libérer les hommes de certaines tâches serviles, cela ne change pas la donne, qui vient de notre nature humaine : il nous faudra toujours travailler !
Là où Graeber a raison, c’est que, comble de l’absurde, au lieu de profiter du progrès technique pour se consacrer plus tranquillement aux travaux nobles, il est apparu qu’une grande partie de l’humanité, en particulier dans les pays occidentaux, perd son temps dans des « emplois bidons », excessivement serviles et mécaniques, cherchant l’occupation constante, et la « stimulation constante » — phénomène aggravé par l’omniprésence des écrans, qui « engluent » les esprits et les forcent à être toujours disponibles : plus de vrai rythme, plus de succession entre temps actifs, et temps contemplatifs, entre temps de labeur et de détente (qui n’est pas un relâchement oisif et mou), etc. Chacun derrière son écran, plus de sensation des saisons ni du temps qui passe… L’idéal de l’homme moderne serait de vivre dans une constance de température, d’activité (ou d’inactivité), de stimulation (ou d’hébétude), etc., comme s’il était déjà dans un paradis terrestre… qui ne durerait toutefois qu’un temps ! jusqu’à la mort ! Mais ces emplois bidons étant justement bidons, ils demandent constamment du changement : ceux qui le vivent le savent, il est impossible de maintenir un processus, un système ou n’importe quoi, à commencer par les hommes, plus de trois ans, cinq ans dans les meilleurs cas : tout doit changer tout le temps ! Les systèmes comme les personnes… Cela est paradoxal mais aussi logique : tout doit être médiocre et constant, tout en empêchant la stabilité et l’enracinement…
Notre auteur américain a donc raison : le monde contemporain, via la révolution salariale, a créé un monstre froid et mécanique, assurant le confort des corps et la torture morale des esprits, en tentant de réduire l’homme à la portion congrue de sa part animale et « calculatoire », pour ne pas dire robotique, ce qui est hautement dangereux pour son équilibre naturel et donc pour son salut.
David Graeber souligne l’institutionnalisation des bullshit jobs, qui sont devenus la règle. On ne travaille plus que pour un salaire, plus rien de noble, de moral ou même d’utile… Sorte de conséquence croisée de l’orgueil démocratique, de la licence du libéralisme, de la cupidité capitaliste et de l’avilissement hédoniste…
La situation devient d’ailleurs tellement absurde que notre époque ne perd plus seulement les âmes, mais aussi les personnes : suicides, burn-out, dépressions, drogues, obésité, stress… Tout indique que les gens sont « paumés », en mal-être constant, malgré les masques qu’ils se donnent, quand ils y arrivent encore, face à cette tension existentielle que provoque l’absurdité de ne pas agir pour son perfectionnement moral (dans le domaine naturel) et de ne pas agir pour Dieu (notre fin dernière). La restauration, en la matière, consiste ainsi à retrouver le « sens » du travail : c’est-à-dire de travailler pour Dieu, pour le Roi, et pour la Maison à laquelle nous appartenons.
Heureusement, quelque soit la difficulté de notre situation, il est possible, toujours, de s’extraire de ces situations, soit concrètement — mais il faut pouvoir, en avoir la force et le courage — soit moralement — et nous apprenons ainsi à être dans le monde sans être du monde.
L’importance du contemptus mundi (mépris du monde) et du détachement des choses de ce monde est le seul remède pour calmer les accès les plus violents de cette robotisation de l’humanité. Il s’agit ensuite — en fait, c’est concomitant et conséquent — de s’attacher à Dieu, et d’aimer Jésus par Marie.
Nous parlons du sujet avec d’autant plus de facilité que, avec nos 32 ans, nous faisons un emploi bidon depuis près de 10 ans. La Providence, toujours bonne, nous a mis dans une situation un peu spéciale, qui fait que, grâce à Dieu, jamais ce carcan ne parvint à nous broyer : au contraire, absurdités sur absurdités nous ont vacciné pour des générations sur la robotisation et la stérilisation générales du « grand capitalisme mondialiste » !
Il est ainsi évident que l’ancienne France, peuplée de petits paysans, artisans, commerçants, qui avaient la main sur leur portion de Création, qui pouvaient exercer pleinement (et en toute responsabilité) leur liberté dans leur petit pré-carré, était bien plus humaine et parfaite : cette sorte de féodalité économique ancrait le bon sens chez tous, permettait d’exercer plus parfaitement les vertus, puisqu’une vertu exercée librement a plus de mérite que celle exercée sous la contrainte (y compris la contrainte situationnelle ; agir par contrainte d’orgueil, pour sa fierté personnelle par exemple, est aussi une contrainte et pas l’une des moindres). Toutes ces petites libertés venaient d’ailleurs limiter les libertés des puissants, puisque chacun avait comparativement un domaine plus particulier que l’employé d’aujourd’hui, qui n’a plus aucun domaine, si ce n’est pas délégation et encore.
Aujourd’hui nous avons une société de robots, ce qui est pire que des esclaves, car des esclaves au moins restent hommes, là où le robot ne fait qu’exécuter mécaniquement, et sans considération du bien ou du mal… Voire, pire, cette société de robots maintient les âmes dans des situations de quasi-péché : tout le monde croit honnêtement qu’il est libre et qu’il vaut beaucoup, alors qu’il ne vaut rien, et tout le système démocratique tient par l’orgueil de chacun qui accepte, pour se croire important, de devenir un robot : le vil esclave n’avait pas cette tentation d’orgueil, il était clair qu’il n’était rien, et sa situation le préservait au moins de l’orgueil.
Les mondes païens avaient ainsi l’esclavage, la chrétienté la liberté à tous les niveaux pour le perfectionnement de la vérité, et la modernité, retour à un paganisme apostat, se fourvoie dans la contre-nature : en supprimant autorité et maîtres (dans les idées, car dans la réalité cela ne disparaît jamais) elle veut faire des gens des robots, de pures instruments, dans un totalitarisme excessif, qui avilit l’homme non pas simplement au statut de l’esclave, qui était un bon instrument humain d’un maître, mais d’un robot calculatoire, rouage d’une grande machinerie d’entreprise ou social, géré par les process inhumains et la gouvernance désincarnée, sans jamais de contact avec un chef incarné dépositaire d’une véritable autorité… Les vrais chefs, peu nombreux quand ils existent encore (et ne sont pas dissous dans la gouvernance), sont si éloignés de la réalité qu’ils peuvent devenir des tyrans sans aucun frein… Les « caporaux » à toutes les échelles sont tout autant des robots que leurs subalternes, ils se croient puissants, mais ne le sont pas, et au fond ils le savent ; ils ne peuvent donc se détourner de leur tristesse que par l’abus de pouvoir ou la distraction et l’oubli.
Car l’homme n’est pas un robot, alors, sauf à s’aveugler et à s’oublier, il ne peut pas supporter indéfiniment cet avilissement : tout l’attire vers l’eau de source vive, Jésus-Christ. Là est la grande espérance : plus on assoiffe quelqu’un, plus le jour où il goutte un peu d’eau, il revit d’une vivacité peu commune, et se rend compte de ce qu’on lui a fait subir.
Alors revenons aux pieds du Roi, qui est aux pieds de Dieu, et finissons-en avec le règne des emplois bidons !
Antoine Michel
Pour Dieu, pour le Roi, pour la France !
