Entretien avec Franck Bouscau à propos du livre « Succession de France et règle de nationalité »
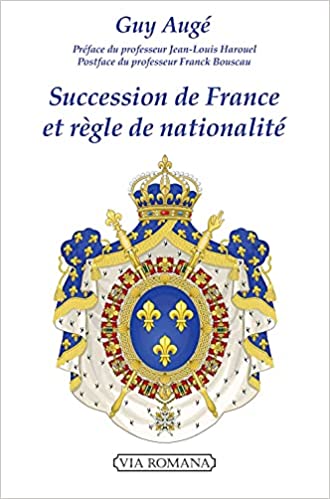 Entretien avec le Pr. Franck Bouscau, historien du droit, avocat honoraire, président de l’Association des Amis de Guy Augé et directeur de la revue La Légitimité[1].
Entretien avec le Pr. Franck Bouscau, historien du droit, avocat honoraire, président de l’Association des Amis de Guy Augé et directeur de la revue La Légitimité[1].
Vous venez de postfacer la réédition de l’ouvrage de Guy Augé Succession de France et règle de nationalité. Pouvez-vous nous résumer la thèse de cet ouvrage ?
Avant de discuter la question, un petit rappel généalogique concernant les Bourbons est nécessaire : Louis XIII a eu deux fils : Louis XIV et Philippe, duc d’Orléans. Louis XIV lui-même a eu un seul fils légitime survivant, Louis, le Grand dauphin, lequel a lui-même engendré trois fils : Louis, duc de Bourgogne, Philippe, duc d’Anjou et Charles, duc de Berry (sans postérité).
Les descendants de Louis, duc de Bourgogne ont été rois de France, effectifs ou rois de droit, depuis son petit-fils Louis XV jusqu’à Henri V Comte de Chambord (qui n’a pas effectivement régné). À la mort sans postérité de ce prince, en 1883, ses droits à la couronne devaient, suivant les principes monarchiques traditionnels, passer à l’aîné de la branche suivante, donc l’aîné des descendants de Philippe, duc d’Anjou, lequel était devenu roi d’Espagne sous le nom de Philippe V. Cependant cette succession fut réclamée par Philippe, duc d’Orléans (appelé « comte de Paris »), aîné des descendants du frère de Louis XIV. Il y a donc une querelle dynastique entre les aînés (« Bourbon Anjou », branche des Bourbons d’Espagne) et les cadets (« Orléans. »)
L’on précisera que le père de ce Philippe d’Orléans, Louis-Philippe avait été « roi des Français » entre 1830 et 1848, en usurpant la couronne au détriment de son cousin Charles X qui était alors le chef de la branche aînée.
- La thèse de l’ouvrage de Guy Augé, Succession de France et Règle de Nationalité, paru pour la première fois en 1979, et reprenant pour l’essentiel une série d’articles publiés en 1964 dans la revue Tradition française est une synthèse de l’argumentation légitimiste « blanc d’Espagne » concernant la succession à la couronne de France. Il comporte une analyse très précise des lois fondamentales qui régissaient la transmission du pouvoir suprême sous l’ancienne monarchie.
Le thème principal de l’ouvrage est la réfutation de l’un des piliers de l’argumentation orléaniste-fusionniste[2], la prétendue « règle de nationalité. » En effet, les partisans de la branche cadette d’Orléans soutiennent que la branche aînée subsistante, issue de Louis XIV par Philippe, duc d’Anjou, devenu roi d’Espagne sous le nom de Philippe V, serait écartée de la couronne de France en vertu d’un certain « vice de pérégrinité », c’est-à-dire qu’elle serait devenue étrangère à la France.
Le dessein principal de l’ouvrage de Guy Augé est de réfuter cette prétendue règle et de montrer qu’une telle loi fondamentale n’existait pas sous l’Ancien Régime. Cependant son propos est beaucoup plus vaste : ainsi, dès le premier chapitre, fait-il place nette en réfutant l’autre pilier de l’argumentation orléaniste-fusionniste, les renonciations d’Utrecht, sur lesquelles nous reviendrons.
Ajoutons encore que l’ouvrage de Guy Augé est une démonstration juridique très rigoureuse, mais qu’il y ajoute très finement la prise en considération de l’aspect sentimental qui est très présent dans cette controverse dynastique.
Sans le mentionner toujours expressément, nous reprendrons à notre manière, dans ces quelques remarques, les arguments que présente l’ouvrage de Guy Augé.
La loi salique ne contient-elle pas en germe la règle de nationalité, puisqu’elle visait à empêcher que le royaume « tombe en quenouille » et donc soit transmis par les femmes à un prince étranger ?
Pour justifier la prétendue « règle de nationalité », certains ont soutenu que la « loi salique » la contenait en germe, puisqu’elle visait à empêcher que le royaume ne « tombe en quenouille » et donc ne soit transmis par les femmes à un prince étranger.
Il y aurait beaucoup à dire sur la loi salique. Celle-ci a été alléguée à la fin du XIVe siècle, alors que les femmes avaient déjà été écartées de la succession la couronne en 1316, 1322 et 1328. À vrai dire, depuis l’origine de la monarchie, la question d’une succession féminine à la couronne n’avait jamais été posée. Cependant, après l’an mil, étant donné que les femmes pouvaient désormais succéder aux fiefs (exemple : Aliénor d’Aquitaine), ce qui n’était pas le cas auparavant, leur droit à coiffer la couronne a pu être envisagé.
L’argument suivant lequel le royaume ne pouvait « tomber en quenouille » issu d’un détournement astucieux d’un passage évangélique (« Les lys ne travaillent ni ne filent ») est lui aussi une justification a posteriori.
À vrai dire, lors des successions de 1316 et 1322, il s’agissait pour deux des fils de Philippe le Bel, les rois Philippe V et Charles IV, d’écarter leurs nièces du pouvoir. Il s’agissait d’enfants en bas âge et leur futur mariage éventuel avec des souverains étrangers (outre le fait qu’il était tout à fait possible de l’éviter puisqu’il n’avait pas encore eu lieu) n’était pas au centre du litige dynastique. En fait, les tenants du pouvoir préféraient un roi adulte et apte à gouverner le royaume en paix et en guerre, plutôt qu’une reine mineure est soumise à divers aléas (régence, mariage futur et rivalités de clans nobiliaires).
Ceci dit, l’exclusion des femmes à deux reprises avait abouti à la naissance d’une coutume. En 1328, la loi des mâles établie par ces deux précédents a été étendue des princesses à leurs descendants : pour succéder à Charles IV, l’on a préféré un parent plus éloigné par les mâles, Philippe VI, comte de Valois, plutôt qu’un parent plus proche par les femmes, Édouard III d’Angleterre. L’exclusion d’Édouard a été présentée comme une conséquence de l’exclusion de sa mère. Il est cependant probable que si une considération « nationale » a également joué, ce n’est pas celle à laquelle l’on penserait au premier abord. Édouard III, prince possessionné en France, petit-fils de Philippe le Bel, était de culture française et notamment ne parlait que français. Cependant son accession au trône aurait probablement entraîné une substitution de son entourage d’outre-Manche à l’entourage royal français en place…
Le fait que la loi des mâles, depuis assimilée à la loi salique, ait de facto écarté des princesses susceptibles d’épouser des souverains étrangers est plutôt une conséquence indirecte, et somme toute heureuse, qu’un objectif de ladite règle.
Pour revenir aux deux principaux arguments de l’orléanisme contemporain, à savoir la « règle de nationalité » et le traité d’Utrecht, quelle est leur importance respective ?
L’on observera tout d’abord que les deux arguments sont contradictoires. En effet, s’il suffit pour un prince de coiffer une couronne étrangère pour être écarté de la succession royale, ainsi que sa descendance, l’on voit mal pourquoi les négociateurs du traité d’Utrecht se sont donné tant de mal pour élaborer des renonciations. Il aurait suffi, si la règle de nationalité avait existé, de constater que Philippe V régnait en Espagne. L’existence même de ces négociations, bien établis par les archives, prouve qu’au début du XVIIIe siècle la règle de nationalité n’existait pas. Comme Guy Augé le montre bien, l’argument de nationalité n’a joué aucun rôle sous l’Ancien Régime.
À propos des renonciations, l’on rappellera que, à la suite de la guerre de succession d’Espagne au cours de laquelle la France avait subi de graves défaites, les négociateurs étrangers, notamment anglais, voulaient éviter que, dans l’avenir, la France et l’Espagne (avec leurs immenses dépendances coloniales) puissent appartenir au même monarque. C’est pour cette raison que Philippe V d’Espagne a été obligé d’accepter des renonciations solennelles, lesquelles ont été souscrites en France et en Espagne et entérinées par le traité d’Utrecht.
Il est intéressant d’observer que, au XVIIIe siècle, l’argument tiré des renonciations est quasiment le seul. Personne ne pense à écarter les descendants de Philippe V au nom d’une règle de nationalité. Les juristes français considèrent avec le futur chancelier d’Aguesseau que nos rois n’ont jamais admis qu’étaient devenus étrangers des prince issus de leur sang qui allaient régner à l’étranger en emportant l’influence française. L’argument de nationalité ne prend de l’importance qu’après la Révolution, qui avait elle-même proclamé le « principe des nationalités » et exacerbé les querelles entre voisins européens.
De fait, la valeur juridique des renonciations est toujours apparue très faible. Dès l’époque de la négociation, les Français l’ont indiqué honnêtement à leurs contradicteurs : pour eux, la loi de succession avait été faite par Dieu lui-même et était intangible. En conséquence, les princes ayant une vocation à ceindre la couronne ne pouvaient ni renoncer à l’avance, ni abdiquer. C’est la loi du royaume qui les appelait à succéder à leur rang, et personne, pas même les intéressés, ne pouvait modifier cela. Il était encore moins possible à un prince de renoncer au nom de ses descendants, car leur droit leur appartenait en propre et était distinct du sien. À quoi les Britanniques répondirent que, de leur point de vue[3], il était permis aux titulaires d’un droit d’y renoncer, et ils y ajoutaient une menace : le bénéficiaire de renonciations pouvait se faire aider pour faire respecter le droit qui lui avait été reconnu. Finalement les Français acceptèrent de signer des renonciations et les Anglais s’en contentèrent : des deux côtés chacun pensait qu’il fallait terminer la guerre et que, si la question d’appliquer les renonciations venait un jour à se poser, ce serait le rapport de forces de l’époque qui en déciderait. En attendant, le mariage rapidement conclu du jeune Louis XV était censé aboutir à la naissance d’une postérité dynaste, et ainsi écarter l’irritante question de l’application ou de la non-application des renonciations. Ce calcul a d’ailleurs bien fonctionné jusqu’en 1883.
Nombre d’hommes politiques, de juristes et d’écrivains ont pris position contre les renonciations qu’ils estimaient nulles. L’avènement de Philippe V en Espagne n’était-il pas, d’ailleurs, une violation de renonciations antérieures à ses droits à ce même trône qu’avait dû souscrire sa grand-mère, Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV ? Et, plus tard dans le XVIIIe siècle, n’a-t-il pas existé un pacte de famille entre toutes les branches de la maison de Bourbon et elles seules, qui montrait que la branche française et la branche espagnole n’était qu’une seule dynastie ? Louis XVI n’a-t-il pas fait connaître sa protestation secrète contre les actes qui lui étaient imposés par les révolutionnaires à son cousin le roi d’Espagne qualifié par lui de « chef de la seconde branche » ? Au début de la Révolution, l’Assemblée Constituante, discutant de la constitution de la royauté, n’a-t-elle pas refusé de préjuger quoi que ce soit sur la valeur des renonciations, ce qui prouve que la question n’apparaissait pas comme réglée ? Au XIXe siècle un certain Gazeau de Vautibault, qui se disait républicain, n’a-t-il pas collectionné les prises de position d’hommes politiques et d’écrivains contraires aux renonciations[4] ?
L’on peut y ajouter la quasi-unanimité des professeurs de droit contemporains, depuis la fin du XIXe siècle, et plusieurs thèses de droit, confirment cette nullité des renonciations. Et l’argument de l’indisponibilité de la couronne, suivant lequel l’ordre de succession ne peut être modifié par la volonté humaine, vient de loin : n’a-t-il pas été exprimé au début du XVe siècle, en 1419, par un juriste méridional, Jean de Terre Vermeille, dans des « Tractatus », qui visaient à réfuter par avance le transfert de la couronne des Valois au roi d’Angleterre prévu par le traité de Troyes (qui a été ratifié en 1420) ? Le traité d’Utrecht pourrait-il réaliser ce que le traité de Troyes était impuissant à faire ?
En résumé, l’argument des renonciations est considéré comme dénué de valeur par les juristes. Certes, quelques politistes modernes veulent faire prévaloir le volontarisme du droit des traités sur l’esprit traditionnel. Mais il s’agit là de constructions modernistes assez mal assurées. En outre, faiblesse supplémentaire, ce qu’une norme volontaire, loi ou traité, a fait, une autre peut le défaire. Les renonciations de la reine Marie-Thérèse ont été remises en cause par le testament de son frère, le roi d’Espagne Charles II. L’on ne voit pas pourquoi les renonciations de Philippe V seraient intangibles, si on supposait qu’elles aient eu quelque valeur au début. Louis-Philippe, futur « roi des Français », alors duc d’Orléans, le savait bien, puisque, lorsque le roi d’Espagne a modifié la loi de succession espagnole pour permettre à sa fille Isabelle II de régner, il a protesté auprès du prince de Polignac, premier ministre, en disant que cette décision espagnole remettait en cause l’ordre de succession français et ressuscitait des prétentions concurrentes de celles de sa branche…
L’on ne saurait davantage admettre, comme un collègue professeur de droit a tenté de le faire, que les renonciations, nul au plan droit constitutionnel français, seraient devenues en quelque sorte une des bases du droit européen et international. L’on rappellera à ce sujet que, en droit français actuel, un traité contraire à la constitution ne peut être ratifié et entrer en vigueur qu’après modification de celle-ci : or le traité d’Utrecht n’a été précédé d’aucune modification valable de la loi de succession française pour la bonne raison que celle-ci était intangible.
Il a déjà été répondu sur la succession de 1328 opposant Philippe VI à Édouard III d’Angleterre. Un autre argument que l’on rencontre parfois et celui de l’accession au trône d’Hugues Capet. Celui-ci aurait été le candidat « français » contre Charles de Basse-Lorraine, carolingien, qui aurait été le candidat « allemand ». Cette argumentation est totalement anachronique. Guy Augé montre que la connaissance que nous avons de l’élection d’Hugues Capet vient d’un seul chroniqueur, Richer, qui est loin d’être toujours fiable. Par ailleurs Hugues était en très bons termes avec l’Empereur germanique, auquel il était d’ailleurs apparenté. Celui-ci, issu de la dynastie de Saxe, était sans doute peu désireux de voir réapparaître un carolingien à l’Ouest de l’Europe. Charles de Basse Lorraine était au demeurant pour lui un mauvais vassal. Enfin les nations française et allemande n’étaient pas vraiment formées, ni même ébauchées, à cette époque antérieure au miracle capétien qui transformera la Francia occidentalis, assemblage de territoires divers, en un État-nation.
Guy Augé montre aussi que le célèbre arrêt Lemaistre, rendu par le Parlement de Paris (plus haut tribunal du royaume) en 1593, qui déclare que la couronne ne peut échoir à aucun prince « étranger », a été plus ou moins volontairement mal compris. En effet si l’on regarde qui sont les « étrangers » que cet arrêt vise, l’on se rend compte que plusieurs sont de nationalité française au sens moderne. En réalité, les « étrangers » que vise l’arrêt sont les étrangers à la famille capétienne. C’est pourquoi Guy Augé propose de remplacer le terme « loi de nationalité » par le terme « loi de sanguinité », plus approprié.
L’on peut encore remarquer que l’on considère généralement que le fait pour un prince de régner dans un pays lui donne la nationalité de ce pays. À ce titre, Henri III était devenu polonais par son élection au trône de Pologne quelques années avant son accession à la couronne de France. Augé a d’ailleurs trouvé un auteur isolé qui le lui reproche, mais sans que cela ait eu le moindre effet au moment de monter sur le trône de France. De même, Henri IV était-il Roi de Navarre après son père Antoine de Bourbon. Et la Navarre était un royaume distinct de la France (il y a même eu des guerres entre les deux royaumes à l’époque de Charles le Mauvais, roi de Navarre et prétendant au trône de France).
Depuis la première édition du livre, en 1979, la situation a considérablement changé. En particulier, les chefs de la maison de Bourbon sont beaucoup mieux connus qu’alors. Pensez-vous que la connaissance de leurs droits dynastiques ait également progressé ?
Depuis la première édition du livre de Guy Augé, il y a quarante ans, la situation du légitimisme a en effet évolué. En particulier, la revendication légitimiste et l’argumentation qui la soutient sont mieux connus du public. En 1987, le millénaire capétien a permis de faire connaître le duc d’Anjou de l’époque, le Prince Alphonse de Bourbon, dont la personnalité attachante a connu une certaine médiatisation. Diverses cérémonies commémoratives et de nombreuses publications comme La Légitimité ou la Feuille d’Information Légitimiste ont permis aux Français de mieux connaître l’existence des princes Bourbon-Anjou et le sérieux de leurs droits. Il y a également eu le « procès du millénaire », imprudemment tentée par le fils du prétendant orléaniste de l’époque, qui a abouti par l’affirmation par les tribunaux de la République (Tribunal de Grande Instance de Paris en 1988 et Cour d’Appel de Paris en 1989) du droit pour l’ aîné des Bourbons de se titrer « duc d’Anjou » et de porter les pleines armes de France… L’honnête homme sait désormais que la lignée aînée existe toujours et qu’elle est prête à assumer ses droits et obligations. Par ailleurs, le nombre et la qualité des initiatives diverses (manifestations, commémorations, messes, pèlerinages, conférences, expositions, associations…) sont autant de traductions du sérieux et de l’implantation du courant légitimiste. Celui-ci a désormais trop d’importance pour qu’un silence, une absence de réfutation ou une argumentation courte puisse en venir à bout, comme ses adversaires l’espéraient naguère…
L’on peut aussi remarquer que, après une forte tension entretenue par Henri, comte de Paris, père de l’actuel prétendant Orléans, les relations entre les chefs des deux branches, Louis, duc d’Anjou (« Louis XX ») et Jean d’Orléans (« Jean IV » pour les orléanistes) sont désormais correctes. Le temps des polémiques inutiles semble terminé. L’on constate aussi un certain accord sur les principes entre les tenants des deux branches qui souhaitent pour la plupart une monarchie traditionnelle et catholique.
Peut-on expliquer que pendant un siècle environ après la mort du comte de Chambord un grand nombre de royalistes peu portés au libéralisme ont soutenu les droits des princes d’Orléans ? Y aurait-il eu contamination du royalisme par une idéologie, par exemple le nationalisme ?
À la mort du Comte de Chambord, en 1883, il y a eu une captation de l’héritage par les partisans des Orléans et un flottement du côté des légitimistes. À cette époque, l’idée de la « fusion », considérer que le duc Philippe d’Orléans « comte de Paris » de l’époque (petit-fils du roi usurpateur Louis-Philippe Ier), pouvait somme toute être l’héritier du comte de Chambord, et que cette réunion des princes et de leurs partisans faciliterait une restauration. Après 1883, le duc lui-même, sembla s’y prêter, en décidant de s’appeler « Philippe VII » plutôt que « Louis-Philippe II ». Dans les années qui suivirent, il y eut un amalgame entre des thèmes issus du légitimisme, d’esprit contre-révolutionnaire, et des thèmes issus de l’orléanisme, devenu conservateur, mais resté libéral.
Cependant une minorité de légitimistes a essayé de maintenir un courant indépendant, malgré des circonstances difficiles. Ils ont eu quelque mérite à faire face à une situation désespérante à vue humaine. En effet, l’aîné dynastique de l’époque, Jean ou Juan, comte de Montizon, chef de la branche « carliste » espagnole était un libéral peu intéressé par la politique. Son successeur Charles ou Carlos était quant à lui un prince contre-révolutionnaire, mais passionnément attaché à l’Espagne et donnant la priorité à ses droits espagnols (pour des raisons honorables, ses partisans ayant combattu lors des guerres carlistes). Dès lors, les légitimistes français qui voulaient suivre ces princes apparaissaient comme des « courtisans de l’impossible », voire des « incurables ». Ils furent peu nombreux, mais le courant se maintint toujours entre ces quelques blancs d’Espagne et les princes qui, aussi abstentionnistes fussent-ils, ne renoncèrent jamais à leurs droits (ce qu’ils ne pouvaient d’ailleurs pas faire comme dit précédemment). L’existence d’une presse peu répandue, mais fidèle, prouve que les aînés ont toujours eu des partisans et que la tradition n’a jamais été interrompue. Après la fin de la branche carliste en 1936, c’est la branche « alphonsine », seconde branche des Bourbon-Anjou, alors incarnée par l’ex-roi d’Espagne Alphonse XIII, qui est devenue aînée, et donc héritière des droits à la couronne de France. À la différence des précédents, ces princes n’hésitent plus à affirmer leurs droits. Et par ailleurs les circonstances de la restauration monarchique en Espagne ont amené à séparer un rameau aîné, destiné à la France, dont le chef est le prince Louis (« Louis XX »), et un rameau cadet, celui des rois d’Espagne.
L’on ne manquera pas de signaler que, après 1883, nombre de légitimistes se sont retirés de la politique, notamment pour se centrer sur le combat religieux. En outre le ralliement à la République, recommandé par le pape Léon XIII — qui a fait cette fausse manœuvre dans l’espoir d’obtenir un soutien diplomatique pour le Saint-Siège — a abouti à faire fondre les effectifs royalistes.
Dans le royalisme postérieur à 1883, il est indéniable qu’une forte majorité a soutenu les Orléans. Faut-il incriminer une pénétration d’une idéologie étrangère au royalisme traditionnel ? Probablement, mais ce n’est pas le nationalisme. En réalité, ce qui a triomphé en 1883, c’est une conception moderne et moderniste de la royauté. Les orléanistes purs avaient une conception de la monarchie parlementaire et contractuelle. Nombre de légitimistes se sont ralliés à cette conception de la monarchie facile, sans se rendre compte que cette « alliance de la carpe et du lapin » était impossible. C’est cette conception volontariste de la monarchie, plutôt que le nationalisme, qui a amené nombre de légitimistes à se rallier à l’orléanisme-fusionnisme en 1883.
Le refus de reconnaître l’héritier d’une branche devenue étrangère depuis plus d’un siècle et demi a pu jouer un rôle. Cependant le nationalisme était encore dans l’enfance en tant que doctrine. Ce n’est qu’à l’extrême fin du XIXe siècle qu’il en alla différemment avec la naissance de l’Action Française : en effet, cette nouvelle école politique s’est voulue l’expression d’un «nationalisme intégral ». Son principal penseur, Charles Maurras, avait observé, à juste titre, que l’action du Roi de France avait été la condition du rassemblement et du renforcement du pays : le Roi faisait en quelque sorte du nationalisme sans le savoir comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Maurras avait donc conclu son raisonnement politique en faveur de la monarchie : pour lui la restauration de ce pouvoir traditionnel était la condition de la renaissance nationale.
N’ayant aucune affinité avec l’orléanisme politique, l’Action Française exécrait le libéralisme sous toutes ses formes — et les royalistes qui sont passés par son école étaient généralement anti-libéraux. Cependant le primat accordé à la Nation a empêché ce mouvement de se poser la question des droits éventuels d’une branche royale polarisée sur ses revendications espagnoles, et qui n’était plus défendus à l’époque que par quelques fidèles épars et peu influents. Dans le sillage de la majorité des royalistes de son époque, l’Action Française, dont le « système » postulait la figure d’un roi, a considéré, à tort, que les Orléans étaient les véritables héritiers de la couronne. Cependant la doctrine du mouvement était fusionniste plutôt qu’orléaniste : elle ne se réfèrait nullement à Louis-Philippe (sauf pour quelques hommages mesurés à sa politique étrangère prudente) et rejetait l’héritage de la royauté parlementaire.
Un orléanisme authentique et libéral s’est cependant maintenu, au cours de la première moitié du XXe siècle chez certains membres de l’entourage des princes d’Orléans. Dans une remarquable postface de son livre, Guy Augé montre qu’il explique également l’attitude politique d’Henri, « Comte de Paris » (1908-1999), prince soucieux de se démarquer du caractère autoritaire et antidémocratique de l’Action Française. Dans son sillage, quelques journaux ou mouvements comme la Nouvelle Action Royaliste ont développé des thèmes véritablement orléanistes, recherchant la conciliation avec la démocratie moderne.
Néanmoins les gros bataillons du royalisme issus de l’Action Française sont normalement exempts de la contamination libérale. Reste pour eux, comme les y invitait Guy Augé, à retrouver la vraie tradition dynastique. Il est en effet curieux que des nationalistes s’accrochent à une branche royale dont les droits reposent sur un traité imposé par la Grande-Bretagne à la France de Louis XIV à la suite d’une guerre difficile…
La postérité intellectuelle de Guy Augé est importante et son influence intellectuelle paraît appelée à croître à l’avenir.
Son œuvre a mis en évidence une tradition dynastique qui n’avait jamais été totalement interrompue, mais qui n’était plus qu’un mince filet presque confidentiel. Succession de France et règle de nationalité a conforté nombre de juristes dans la conviction du maintien des droits des Bourbon-Anjou. Plusieurs universitaires de qualité, royalistes ou non, sont venus élargir la brèche que Guy Augé avait ouverte dans le prêt-à-penser. Certains ont d’ailleurs ouvertement revendiqué l’influence de sa recherche sur leur propre évolution. Nul doute que la reparution du livre d’Augé, s’il est diffusé dans les facultés de droit, et notamment les sections d’histoire du droit, ne renforce encore cette influence. La revue La Légitimité, qui a repris sa publication sous la direction d’un ami de Guy Augé, le regretté professeur Jean-Pierre Brancourt, et qui continue sa parution, a notamment pour objectif de faire connaître et de diffuser l’héritage intellectuel de Guy Augé, défenseur de la vraie tradition dynastique française et d’une royauté tempérée, équilibrée par les principes de la philosophie thomiste.
Entretien réalisé par Guillaume de Thieulloy
[1] L’entretien, mené par Guillaume de Thieulloy, fut initialement publié sur le site des éditions Les 4 Vérités : https://www.les4verites.com/culture-4v/succession-de-france-et-regle-de-nationalite. Nous le publions sur Vexilla Galliae avec l’aimable autorisation de l’auteur.
[2] Le terme « orléaniste » désigne les partisans des princes d’Orléans. Certains méritaient cette appellation par leur adhésion à l’usurpation commise par Louis-Philippe, duc d’Orléans, devenu « roi des Français » à la suite de la révolution de 1830 qui avaient chassé son cousin Charles X. D’autres, appelés « fusionnistes », sans tenir compte de l’usurpation, considéraient que les princes d’Orléans étaient les successeurs naturels des Bourbons de la branche aînée descendante du duc de Bourgogne, à partir de la disparition de celle-ci. Les deux courants ont convergé, d’où le terme « orléanisme–fusionnisme. ». Cependant, alors que l’orléanisme exprime une préférence pour la branche cadette, jugée plus apte que la branche aînée à concilier la monarchie et les principes issus de 1789, le fusionnisme prétend être une application du droit dynastique .
[3] Certaines monarchies, comme la Grande-Bretagne ou l’Espagne, admettent les abdications et renonciations.
[4] Théodore-Paul Gazeau de Vautibault, Contre la fusion, rééd. Paris, Sicre, 2001.

Les pairs s avaient fait renoncer à Jeanne de Navarre d’être reine, Dois-je en déduire que la loi salique n’était pas une loi fondamentale à cette époque?