[Cinéma] La Rose de Versailles, ou « Lady Oscar »
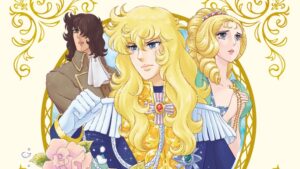
Une version cinématographique du manga Lady Oscar est sortie au cinéma l’automne dernier. Ce manga, appelé dans sa version originelle La Rose de Versailles est du genre dit « Shojo Manga » ou roman à l’eau de rose pour adolescentes , écrit par Ryoko Ikeda. Nous parlons aujourd’hui de ce film, et par là de ce manga, car, malheureusement, il est universellement connu au Japon et il fonde pour de nombreux japonais la vision de la cour de Versailles d’une part, par-là de l’Ancien Régime. Il a également eu son succès en France dans les années 1990-2000, avec l’adaptation en série animée.
D’un point de vue purement fictionnel et romanesque, nous sommes en plein dans le genre du roman à l’eau de rose, avec le triangle amoureux classique entre Marie-Antoinette, Fersen et Oscar, le tout sur fond d’amour platonique, et avec toutes les grandiloquences classiques, et les codes graphiques normaux de ce genre – yeux immenses et brillants, faste de la Cour et frou-frou, etc.
Sur le fond, en revanche, le film comme le manga, reprennent les poncifs historiques en vogue dans l’historiographie révolutionnaire des années 50 et 60. Le manga fut publié en 1972 et 1973, des années noires pour la France et le monde sur fond de révolution triomphante, libération sexuelle, féminisme et victoire de l’esprit de Vatican II détruisant la Foi et les mœurs.
Le manga est bien censé être une fiction, avec d’ailleurs le protagoniste principal, Oscar, un personnage imaginaire, mais tout est fait dans le manga pour paraître vraisemblable, et beaucoup d’esprits peu au fait de l’histoire réelle croit que les faits présentés sont historiques.
Et pourtant non : le manga est d’un point de vue historique catastrophiquement faux, biaisé et parsemé d’erreurs.
Il reprend sans examen la vision historiographique révolutionnaire, avec en plus des erreurs massives que même ces auteurs pourtant très révolutionnaires n’oseraient dire… La fiction et l’imagination semblent permettre toutes les exagérations… Le roman historique est en cela une arme de guerre redoutable, car, utilisé à mauvais escient, et même si l’auteur n’a pas cette intention, il peut créer des images complètement fausses et durables… L’objectif de vendre du papier et de « distraire » les gens ne justifient pas tout…
La seconde caractéristique du biais de ce manga consiste en un phénomène très intéressant de projection de la réalité historique japonais, dure, violente, injuste, sur la réalité d’Ancien Régime. Pour le dire brutalement nous avons dans ce manga non pas une description de la France du XVIIIe siècle d’Ancien Régime, mais le plaquage de la réalité shogounale de l’époque Edo, avec des costumes occidentaux et de Cour française.
Précisons tout de suite aussi que, forcément, l’aspect religieux est complètement absent de ce manga : nous ne voyons jamais un seul prêtre ou clerc malgré leur importance à la Cour, ni évidemment toute l’importance pendant la Révolution de la persécution religieuse et de l’affaire des jureurs.
Nous avons encore des analyses simplistes de la situation géopolitique, qui n’est là que pour le décor : parfaitement dans la fibre du genre roman à l’eau de rose nous avons juste un enchaînement de situations personnelles à la Cour, suivant plus ou moins la vie de Marie-Antoinette – mais sans aller évidemment jusqu’à son procès, et en sous-entendant que c’est bien fait – mais tout cela est secondaire au fond. Le problème c’est que le succès de ce manga bien justement de cet aspect pseudo-historique, qui est antihistorique.
Nous allons prendre quelques exemples pour illustrer cet état de fait.
-
Inversion homosexuelle tordue
Le bât blesse dans le cœur même de l’œuvre. « Lady Oscar » est une jeune femme qui ressemble à un homme à s’y méprendre, et qui est le commandant de la garde rapprochée de la Reine. C’est un personnage entièrement fictif. Nous avons ici la tentation d’inversion homosexuelle : une femme qui fait l’homme et qui veut oublier sa féminité, mais qui revient quand même d’une façon ou d’une autre. Et ce Fersen très efféminé, ainsi qu’André, le serviteur et ami d’enfance d’Oscar, qui en est aussi amoureux. Nous sommes évidemment dans un sentimentalisme étouffant, propre à ce genre de manga et évacuant toute raison et tout amour supérieur.
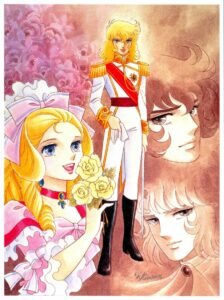
L’œuvre fait ainsi ici le choix de trahir la réalité historique, et cela d’autant plus en mettant au centre une situation absolument impensable sous l’Ancien Régime. Jamais une femme ne peut faire semblant de faire l’homme, encore moins sous les armes, et encore moins en héritant de son père du nom et de la maison… L’Ancien Régime, très catholique, abhorrait évidemment le péché contre-nature de l’inversion, mais aussi enseignait clairement les rôles complémentaires des deux sexes, de façon intelligente. Il arrivait ainsi souvent qu’une femme puisse diriger, en cas de nécessité : par exemple à la mort de son mari et sans héritier majeur, la femme faisait une sorte de régence. L’exemple des reines de France l’attestent plusieurs fois dans l’histoire au plus haut niveau.
La femme, représentant aussi une lignée, héritait ainsi aussi de façon distincte et parfois indépendante, selon les coutumes, de biens et de fiefs sans droit de regard de son mari. Mais tout cela n’a rien à faire avec du féminisme ou autre : simplement du devoir de servir le bien commun d’une lignée, d’une famille, d’un royaume. Une femme pouvait aussi parfois diriger un couvent même d’hommes, selon les particularités historiques.
Mais répétons-le tout cela n’était pas du féminisme, et il n’y avait pas non plus de machisme : la haine de la femme fut justement révolutionnaire. Et l’acharnement sur Marie-Antoinette en est la première manifestation : les révolutionnaires détestaient les femmes, et critiquaient l’Ancien Régime pour son influence et les mœurs considérés comme efféminés de la Cour.
Citons un spécialiste de la question :
« La Révolution, ce n’est pas seulement la victoire de l’égalité sur le privilège, c’est aussi la revanche des hommes sur le monde des femmes. Élisabeth Vigée Lebrun le dit très bien dans ses souvenirs : « Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées. » « Malheur à toute société dont les femmes se font hommes ! » écrit en note l’éditeur d’une version apocryphe du Journal de Cléry. » (Juger la Reine, Emmanuel de Waresquiel, p.176)
Et plus loin : « Les révolutionnaires l’ont bien compris. Toucher à la mère, c’est toucher à la sacralité du lien de l’hérédité monarchique, c’est le trancher et, avec lui, décapiter une nouvelle fois la monarchie. L’enjeu est de taille car le petit Capet est toujours vivant, détenu au premier étage de la tour du Temple sous la garde du couple Simon. Et cet enfant est roi. En avilissant la mère, on avilit aussi le fils. On souille le corps vivant de la monarchie, qui, aux yeux de la République, a cette fâcheuse disposition à ne jamais vouloir mourir. » (Idem, p.182)
En conclusion, l’inversion des sexes proposée dans l’œuvre est moralement problématique et historiquement fausse, d’autant plus fausse qu’elle biaise complètement ce que pouvait représenter la société d’Ancien Régime. Cette inversion illustre plutôt les fantasmes tordus d’une société japonaise des années 1970 qui se fourvoyait de plus en plus dans un épicurisme sans frein.
-
Le 14 juillet 1789
Le film finit par un climax, celui de la journée du 14 juillet 1789, présentée comme la clef de voûte de la Révolution Française. Là encore l’auteur ne fait que reprendre la doxa officielle de la République, que plus aucun historien sérieux n’ose appuyer. On sait que ce jour ne fut pas important historiquement, et on sait surtout qu’il marqué le début des massacres par les Révolutionnaires.
Et ici le film ment éhontément : on fait croire que les officiers royaux et les soldats de la Bastille ont ouvert le feu, se sont défendus et ont fait couler beaucoup de sang, alors que c’est faux ! Le commandant de la Bastille a au contraire refusé de faire tirer et a ouvert les portes de cette forteresse en train de tomber en ruine…ce qui lui valut de retrouver sa tête au bout d’une pique.
Par souci de vérité historique, nous reprenons la description de ce jour et de sa préparation par un spécialiste de la question, Philippe Pichot-Bravard :
« Il régnait alors à Paris et à Versailles un désordre préoccupant qui pesait sur les délibérations des députés. Certains députés, comme l’archevêque de Paris ou le conseiller Duval d’Eprémesnil avaient été agressés au sortir de séances de leur ordre. A la fin du mois de juin, la mutinerie des Gardes-françaises aggrava le désordre. Le Roi annonça alors aux députés, le 1er juillet, son intention de prendre « des mesures pour ramener l’ordre dans la capitale ». Il décida de placer autour de Paris une vingtaine de régiments, dont le commandement fut confié au maréchal de Broglie et l’intendance à Foullon de Doué, Bertier de Sauvigny, Flesselles et d’Aligre. Au sein du Conseil, trois ministres, Necker, Montmorin et Saint-Priest, s’opposèrent à ces mesures.
Le dimanche 12 juillet 1789, la nouvelle se répandit dans Paris que le Roi venait de renouveler son ministère. Le directeur général des finances, Necker, avait été prié de rendre son portefeuille et de se retirer en Suisse dans la plus grande discrétion. Montmorin (Affaires étrangères), La Luzerne (Marine) et Saint-Priest (Guerre) avaient également été congédiés. Louis XVI n’avait conservé auprès de lui que le Garde des Sceaux, Barentin, et le secrétaire d’Etat à la Maison du Roi, Laurent de Villedeuil. Pour le reste, il avait nommé le baron de Breteuil, ancien secrétaire d’Etat à la Maison du Roi, chef du conseil royal des finances, le maréchal-duc de Broglie, secrétaire d’Etat à la guerre, le duc de La Vauguyon, fils de son ancien gouverneur, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Arnaud de Laporte, secrétaire d’État à la Marine et l’intendant Foullon de Doué à l’intendance militaire.
Louis XVI avait voulu rendre à son gouvernement la cohésion qui lui manquait. Par son absence, lors de la séance du 23 juin, Necker avait trahi sa confiance. En outre, Necker, Montmorin et Saint-Priest s’opposaient aux mesures prises le Roi pour remédier au désordre qui touchait Paris et Versailles.
Harangués par des tribuns improvisés, notamment Camille Desmoulins, les promeneurs du Palais-Royal manifestèrent leur attachement à Necker et au duc d’Orléans, dont ils promenèrent les bustes. Au cours de l’après-midi, ils firent le tour des théâtres et les fermèrent d’autorité en signe de protestation. Bientôt des manifestants commencèrent à jeter des pierres sur les soldats rassemblés sur la place Louis XV. Le prince de Lambesc, à la tête du Royal-Allemand, tenta de les disperser. Cette tentative de répression ne fit qu’aggraver l’état d’effervescence des esprits. Dans les heures qui suivirent, Paris fut gagné à l’émeute. Le 13 juillet, une milice bourgeoise, renforcée par des gardes-françaises mutinés, se constitua pour faire face à l’armée. Elle compta bientôt quarante-huit mille hommes. L’armée, dirigée depuis Versailles par le maréchal de Broglie, manifestait des signes inquiétants d’insubordination. De nombreux soldats et sous-officiers refusaient d’obéir à leurs officiers ; des officiers eux-mêmes tournaient casaque, à l’imitation des Gardes françaises. Ceux qui demeuraient fidèles à leur devoir étaient directement menacés. Les échevins de Paris furent remplacés par une commune insurrectionnelle dont le député Bailly prit la tête. Le pouvoir avait changé de mains.
Au matin du 14 juillet, les manifestants envahirent les Invalides afin de se procurer des armes. Puis, avec le même dessein, ils marchèrent sur la Bastille. « Au sortir de l’expédition des Invalides, cinq cents gardes-françaises et deux mille bourgeois s’étaient portés de ce côté », écrit le député Jean-Baptiste Salle. La Bastille, vieille et imposante forteresse bâtie sous Charles V, était devenue un arsenal et une prison d’État. Naguère elle accueillait de grands seigneurs frondeurs et des conspirateurs. Au XVIIIe siècle, quelques hommes de lettres faméliques y avaient reçu une hospitalité confortable, séjour qui, par surcroît, contribuait de manière décisive aux succès de leurs œuvres. L’abbé Morellet avait ainsi bénéficié de ce mécénat involontaire. Coûteuse pour le trésor, la forteresse était destinée à la démolition par Louis XVI. Elle n’accueillait que sept prisonniers de droit commun confiés à la garde de vieux soldats invalides. Le gouverneur était le marquis de Launay, beau-frère du secrétaire d’Etat à la Maison du Roi, Laurent de Villedeuil. Launay opposa aux manifestants une défense hésitante et maladroite. Résistant suffisamment pour les mécontenter sans se donner les moyens de tenir la place. Le maréchal de Broglie voulait lui envoyer des renforts. Il en fut dissuadé par Laurent de Villedeuil qui craignait de froisser son beau-frère en lui donnant à penser que la Cour ne le jugeait pas capable de tenir la place avec les forces dont il disposait. La courtoisie d’Ancien Régime était ici poussée jusqu’à l’absurde. Alors qu’une partie de la garnison faisait défection, refusant de poursuivre le combat, le marquis de Launay capitula. Les vainqueurs de la Bastille commencèrent par massacrer plusieurs invalides. Puis, ils se saisirent du gouverneur qui avait tenté de se cacher. Ils le traînèrent à l’Hôtel de Ville. Tout au long du chemin, malgré le sauf-conduit qui lui avait été remis, le marquis de Launay fut maltraité, grièvement blessé, avant d’être assassiné. Son corps fut dépecé et sa tête promenée au bout d’une pique.
Le détail est d’une importance capitale. L’irréparable venait d’être commis. Cette tête était la première d’une collection pharaonique. Immédiatement, la foule prit goût au sang. Quelques instants plus tard, la tête de Jacques de Flesselles, prévôt des marchands de Paris, vint rejoindre celle du gouverneur de la Bastille. Dans les heures qui suivirent, des tribunaux populaires s’établirent aux quatre coins de Paris, prononçant des sentences expéditives. Quelques jours plus tard, le 22 juillet, l’ancien ministre Foullon de Doué, malgré ses soixante-quatorze ans, fut à son tour pendu à une lanterne, la bouche pleine de foin. Son gendre, Bertier de Sauvigny, intendant de la généralité de Paris, fut massacré quelques instants plus tard. Les cibles n’avaient pas été choisies au hasard. Ces premiers massacres, spectaculaires, jugés nécessaires par certains députés du Tiers comme Duport ou Robespierre, visaient à désorganiser l’administration de la monarchie. Lorsque les intendants apprirent le supplice sauvage subi par le plus éminent d’entre eux, ils s’empressèrent d’émigrer ou de démissionner. La tête de Bertier de Sauvigny, agitée comme la tête de Méduse, suffit à détruire l’édifice de la monarchie administrative. La sauvagerie de ces premiers supplices venait d’inaugurer le règne de la terreur. Ainsi, selon Malouet, député du Tiers-État : « La Terreur, dont les républicains purs ne proclament le règne qu’en 1793, date, pour tout homme impartial, du 14 juillet, et je serais personnellement en droit de la faire remonter plus haut ». A Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte tiendra un discours similaire, en insistant sur la dimension sociale du mouvement : « Comment dire à tous ceux qui remplissent toutes les administrations, possèdent toutes les charges, jouissent de toutes les fortunes : Allez-vous-en ! Il est clair qu’ils se défendraient : il faut donc les frapper de terreur, les mettre en fuite, et c’est ce qu’ont fait les lanternes et les exécutions populaires. La Terreur, en France, a commencé le 4 août… ». » (La révolution française, Philippe Pichot-Bravard, éd. Via Romana)
Je le répète, cette œuvre romanesque est d’autant plus néfaste qu’elle est bien ficelée et psychologiquement comme narrativement plausible. Mais tout est faux et mensonger !
-
La projection erronée de l’ancien Japon sur l’ancienne France
Nous touchons ici certainement au point le plus intéressant de notre humble analyse et qui semble être passé inaperçu pour de nombreux protagonistes. Il s’agit de la projection de l’histoire du Japon sur la France, de façon frappante d’une part et tout à fait fausse historiquement. Cet aspect illustre d’ailleurs cette tradition historiographique japonaise de croire que Japon et Europe (ici en l’occurrence la France) aurait une histoire semblable, égal, ce qui est une façon de nourrir l’orgueil japonais et de se rassurer sur sa situation présente. Cela est historiquement une très grande erreur, puisqu’une étude poussée de la question montre très rapidement que les sociétés d’Ancien Régime et de l’Ancien Japon, malgré des ressemblances superficielles, sont en fait fondamentalement opposés dans leur esprit et leurs institutions. En un mot la différence vient de l’effet du catholicisme sur les institutions, la royauté et la société. Nous ne pourrons rentrer dans tous les exemples, mais du moins nous essaierons de donner quelques éléments de réflexion, en mettant en perspective les façons de faire au Japon et en France « médiévale » sur des sujets semblables.
-
Jugement sommaire et injuste du Roi Louis XV sur un serviteur
Résumons la scène. André, le valet d’Oscar, lors d’un jeu à cheval avec le Dauphin provoque un pur accident qui n’est pas de sa responsabilité propre. Cet accident aurait pu être grave pour la princesse, mais finalement rien ne se passe.
Et ensuite Louis XV convoque André et son maître, Oscar, en majesté, pour le juger et exiger sa mort. Il va finalement être sauvé par Oscar qui se livre à sa place pour provoquer la grâce du Roi.
Cette scène est le fruit de l’imagination qui projette une réalité japonaise sur un passé français, mais qui n’a jamais existé dans la réalité !
Cette scène est typiquement ce qui pouvait se passer dans le Japon ancien où le pouvoir du maître, du seigneur, du Roi, aussi étendu que celui du pater familias romain, avait droit de vie et de mort sur tous ses sujets et sa « familia », et cela sans véritable procédure rigoureuse quand il s’agissait de « ses gens ». C’est la réalité de la domination païenne où le maître possède non seulement ses esclaves et domestiques mais au fond tous ses gens, toute sa famille.
Or cet état de fait est absolument inconnu dans la Royauté très chrétienne : le pouvoir du Roi est évidemment limité par des lois supérieures, celle de Dieu, la loi naturelle, les lois de l’Église, les coutumes et les procédures du droit. Jamais le Roi ne pouvait juger ses gens de cette façon, et le droit devait aussi s’appliquer : pas de procès sommaire dans l’ancien Régime. Les nombreux officiers royaux, dépositaires de la justice, et en particulier les Parlements en témoignent d’ailleurs, eux qui n’ont pas hésité à bloquer le fonctionnement royal paralysant toute réforme dans le Royaume. Les faux scandales créés par Voltaire sur des affaires comme le chevalier de la Barre ou l’affaire Calas montrent en creux que ce genre de scène était impensable : ces Lumières-vipères auraient sautés sur l’occasion pour attaquer la Royauté. Ils ne l’ont pas fait et n’ont même pas essayé de mentir sur le sujet, tellement la chose était impossible et impensable.
Soulignons de plus que si le Roi pouvait juger personnellement c’était soit en lit de justice – pour faire passer une décision solennellement – ou avec des procédures très claires, et toujours impliquant officiers et institutions. Jamais il ne pouvait de son propre fait décider de juger une affaire sommairement.
Cette scène est d’autant plus farfelue qu’elle ignore de façon crasse les rudiments de la morale chrétienne : on ne peut jamais condamner gravement quelqu’un qui n’est pas fautif, qui n’a pas une culpabilité, même si cela entraînait la mort. L’homicide involontaire avait déjà des peines allégées, et en fonction la culpabilité pouvait être complètement effacée. Ici, il n’y a même pas de blessé ni rien : et rien non plus qui corresponde de près ou de loin à un crime de lèse-majesté ou un attentat sur un membre de la famille royale. En terre chrétienne, on ne saurait condamner quelqu’un à mort pour un pur accident fortuit et involontaire.
La scène, en contexte français, est ainsi absurde, et faussant l’image de ce temps au contraire éminemment juste : elle n’a de sens, et ne résonne dans les esprits, que pour un public japonais qui vivait encore cela quotidiennement il y a à peine 150 ans (100 ans au moment où le manga est paru, soit les arrières-grands-parents environ), et peut-être aussi pour le français contemporain qui commence aujourd’hui à expérimenter ce genre de situation.
-
Caricature du noble seigneur bat un pauvre qui passe devant son carrosse.
L’autre scène tout aussi absurde en contexte français et tiré du passé japonais est celle où un noble bat presque à mort un paysan, un enfant qui plus est (il faut faire pleurer dans les chaumières, c’est le genre qui l’impose) qui a « osé » passer devant sa calèche, encore sans faire exprès. Le paysan est sauvé in extremis par André, et le noble aussi par lui, sauvé du lynchage populaire.
Cette scène vient contredire frontalement toute la réalité de la noblesse française, pétrie de chevalerie chrétienne (protéger la veuve et l’orphelin) et de « noblesse oblige ». A la suite de Jésus-Christ qui le Jeudi saint fait le travail de l’esclave en lavant les pieds de ses Apôtres et en leur ordonnant de se laver les pieds des uns des autres, les chefs chrétiens que sont les nobles avaient ce même devoir, et en effet l’appliquaient le plus souvent, car c’était leur honneur qui étaient en jeu.
Jamais ce genre voie de fait n’aurait pu être toléré.
Là encore le droit vient prouver notre propos : en royaume de France, les nobles étaient non seulement soumis à la loi comme tout le monde, mais le fait d’être noble était un facteur aggravant dans les peines. A crimes égaux le noble était plus sévèrement puni que le paysan !
Au Japon et en terre païenne c’est l’inverse : la loi (positive) n’est réservée que pour le petit peuple, et les aristocrates, la Cour et les seigneurs sont au-dessus de la Loi. Ils sont juste régulés par l’étiquette pour éviter qu’entre eux ils s’entretuent trop, mais ils ont tout pouvoir envers ceux soumis à la loi, le peuple. Cette sorte de fonctionnement oligarchique n’est pas sans rappeler ce qui se passe aujourd’hui dans nos sociétés révolutionnaires ou une certaine classe élitiste est de facto au-dessus des lois, pouvant ne plus être atteintes par eux, ou de moins en moins, et où les lois deviennent de plus en plus vexatoires pour le simple ; dans cette logique où le puissant peut disposer de l’humble pour son propre intérêt.
Cela n’existait pas dans l’ancienne France ! Et les contrevenants n’avaient pas besoin d’un lynchage populaire pour être puni, la justice s’en chargeait – pensons au cas fameux de Gilles de Rais, ce lieutenant de Jeanne d’Arc, fait maréchal, mais sordide violeur d’enfants, qui va se faire condamner à mort par la justice malgré sa position éminente dans le royaume.
Cette scène du film, encore une fois, est une projection de la réalité japonaise sur un passé français. Ce fait de traverser le cortège seigneurial entraînant une exécution à mort sur place était quelque chose de bien ancré dans le Japon d’Edo. Les premiers étrangers en furent d’ailleurs victimes à de nombreuses victimes, le plus célèbre étant l’incident de Namamugi en 1862 où quatre anglais furent assassinés pour avoir traversé le cortège d’un grand seigneur…
-
La Figure de Marie-Antoinette et de Louis XVI, dans la doxa révolutionnaire
Les figures royales sont désespérément dans le cliché historiographique révolutionnaire d’un Louis XVI benêt et mou et d’une Marie-Antoinette frivole.
L’historiographie sur ce point a bien évolué et montre combien Louis XVI fut en fait un grand roi qui dut composer avec une situation extraordinairement compliquée et combien Marie-Antoinette fut soucieuse du bien commun. Il suffit de lire la biographie de Louis XVI de Jean de Viguerie ou « Le procès de Marie-Antoinette » de Emmanuel de Waresquiel pour se rendre compte de cette réalité.
Il suffit encore de lire le testament de Louis XVI pour se rendre compte de la profonde Foi du Roi et du dévouement jusqu’au sacrifice du Roi pour la France et ses sujets, même révolutionnaires. La dignité et la résignation de Marie-Antoinette témoignent encore d’une réalité complètement opposée à ce que ce film et manga présentent.
Pour conclure, le genre du roman historique ou de toute littérature qui brode imprudemment et librement sur nos histoires posent toujours un problème dès que le but assigné n’est pas de retranscrire fidèlement une époque mais de « distraire » son public ou projeter des fantasmes et des complexes personnels sur des personnages et des temps complètement autres.
Les conséquences sont lourdes, car l’image s’ancre dans les esprits et le profane, même de bonne foi, même en fait assez éclectique, mais non spécialiste de la question, ne peut pas démêler facilement le vrai du faux et sera trompé d’une façon ou d’une autre.
Nous ne pouvons que souhaiter que de nouveaux films ou documentaires, comme il en existe déjà : le film sur le procès de la reine, ou Vaincre ou mourir sur Charrette, se multiplient pour rétablir la balance sur la réalité de l’Ancien Régime et de la Révolution française.
Le visionnage de ce film nous a encore fait prendre conscience de l’importance de la confiance accordée à l’auteur pour ce genre : ni sources, ni notes, ni rien pour vérifier ce qui est dit, il ne reste plus que le crédit de l’auteur…
Paul de Lacvivier
