Le sport comme une religion, Paul de Beaulias
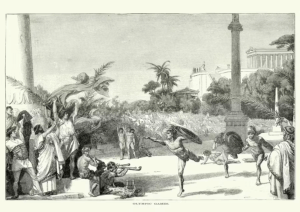
Je me retrouvais tantôt, le premier mardi du mois de novembre, à devoir participer au derby de Melbourne, rediffusé en direct à Tokyo pour la communauté australienne. L’ambiance était assez irréelle : tout le monde sur son 31, femmes en belles toilettes et chapeaux recherchés dans une salle de gala d’un des plus grands hôtels tokyoïtes, avec bons vins et bonne chère. Sauf qu’avec la distance la course est retransmise sur un grand écran : le derby sans le derby, l’ambiance « Belle époque » en digital.
Le monde de la course, le monde australien en particulier et anglo-saxon (nouveau monde) en général me sont étrangers. J’apprends assez rapidement, à mon grand étonnement, que ce derby est un jour férié de l’état de Victoria, où se trouve Melbourne. Et pas des moindre, puisque tout s’arrête ce jour-là pour laisser la place à la course et à la boisson… Gare à qui voudrait travailler cet après-midi là à Melbourne, voire même plus largement en Australie.
Alors je m’amuse à demander aux australiens qui sont là, au détour des conversations, le « pourquoi » de ce jour férié. La plupart ne se sont jamais posés la question visiblement et sont étonnés qu’on se la pose.
Sans que personne ne puisse me dire une raison historique ou précise, une réponse du moins est revenue souvent, et fait sens : « parce qu’en Australie le sport est une religion ». Ce commentaire a quelque chose de très profond derrière son apparence de boutade : une fête nationale, un jour de congé étatique a forcément quelque chose de religieux, de sacré, de rituel. Il manifeste pour tel ou tel état ce qui est véritablement important à ses yeux, ce que le temporel veut « sacraliser » ou « sanctuariser ». Dans la Chrétienté ainsi les fêtes étaient avant tout les fêtes chrétiennes, depuis celles qui sont universelles comme Noël ou Pâques, à celles qui sont locales, comme le Patron, la procession ou le pèlerinage local. Il y avait ensuite les fêtes qui ont un sens politique para-religieux, comme la commémoration des morts, de grands événements du passé, du sacre du roi, de baptêmes et mariages royaux, etc., qui montrent la raison d’être d’un pays.
Dans les états modernes et révolutionnaires ces fêtes sont artificielles et servent un tout autre dessein que dans le passé chrétien : elles ne sont plus organiques, coutumières et naturellement institués à chaque niveau de subsidiarité, mais le plus souvent imposés par l’état jacobin pour justement changer la « religion ».
En bref, regardez et analysez les jours fériés dans chaque pays, et province (car hors de la France, soit dit en passant, il est commun que la province, voire la commune aient leurs propres fériés en sus de ceux qui sont nationaux) et vous comprendrez beaucoup de la spiritualité – comme on dit aujourd’hui – de ce pays.
La république en France montre ainsi un paysage composite : fêtes chrétiennes d’un côté (Noël, Pâques, Pentecôte, Toussaint), qui recouvrent aussi les vertus politiques de piété filiale, d’honneurs aux morts, etc., et fêtes ultra-révolutionnaires de l’autre (14 juillet, 11 novembre). Tout ce qui est royal est évidemment effacé. Je place le 11 novembre comme une fête révolutionnaire, en ce sens que sous couvert de mémoire et de piété filiale pour les morts tombés soi-disant pour la France, c’est surtout une exaltation des sacrifiés sur l’autel de la République au moloch révolutionnaire pour la destruction de l’Europe chrétienne… certainement le plus grand drame du vingtième siècle où tant clercs que bons français se sont fait avoir.
Au Japon, nous avons un mixte de fêtes plus ou moins impériales et autour du roman national recréé à la fin du XIXe siècles (fondation du pays, anniversaire de l’empereur), et de « fêtes » sans sens qui sont des prétextes pour faires consommer (golden week, jour de la Montagne, du sport, etc.), avec d’autres qui sont là pour légitimer le régime post-guerre (jour de la constitution, etc.), et enfin quelques-unes sur des vertus naturelles (le jour des anciens).
La religion au Japon se manifeste ici, et avec son histoire : une religion naturelle nationaliste qui se dégrade peu à peu à en religion matérialiste et libérale économique, avec une perte de sens général, même des vertus naturelles…
Et pour l’état de Victoria à Melbourne, la religion ce serait le sport : c’est en tout cas très parlant de la réalité de l’ambiance sur place, et de cette non-culture anglo-saxonne du nouveau monde. Superficiellement ils reprennent des modes vestimentaires et de sociabilité qui n’existent que peu ou plus dans le Vieux Monde, mais tout cela pour boire beaucoup et parier… sans aucune profondeur.
Ils sont plutôt sympathiques et facile d’accès, mais on sent qu’ils n’ont pas de passé ni d’avenir : je rencontre d’ailleurs deux Anglais à ce derby, avec qui j’accroche tout de suite. On parle de guerre de cent ans et entre vieux ennemis on a des codes communs, nous venons de la même vieille Europe, et nous sommes les mêmes héritiers de la vieille chrétienté et d’empires mondiaux… drôle de vivre un rapprochement avec l’Anglais dans ce genre de contexte.
En résumé, rien n’est innocent, et l’importance de la politique essentielle.
Demain un roi revenant en France changera évidemment de façon spontané et naturelle les jours fériés, ce pouvoir si grand du temporel de stopper un instant la vie frénétique des contemporains pour s’attarder à autre chose.
Et si cet autre chose est Dieu, le bien commun, les bonnes choses, alors c’est un apostolat en soi !
Pour Dieu, pour le Roi, pour la France
Paul de Beaulias
